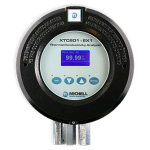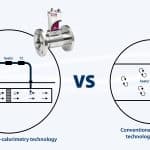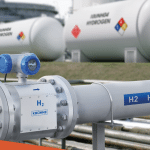La demande croissante en eau dans le monde augmente les risques de surexploitation et de contamination des sources hydrauliques naturelles de surface et souterraines. Face à cette insécurité grandissante, certains pays n’ont d’autre option que de se tourner vers de nouvelles sources non naturelles. Dans ce contexte, le dessalement d’eau de mer représente une solution de plus en plus accessible face à la pénurie d’eau et au stress hydro-politique. Parallèlement, l’utilisation croissante de la technologie pose de nouveaux défis.
L’eau douce, en tant que ressource indispensable, notamment à des fins domestiques, agricoles et industrielles, joue un rôle crucial dans la croissance économique et le développement des États. Avec l’augmentation de la population, la demande en eau à usage domestique s’intensifie. Une population en croissance constante implique également plus de biens alimentaires à produire, avec une demande grandissante dans l’agriculture et les systèmes d’irrigation. Dans les régions déjà touchées par une pénurie d’eau, le changement climatique devrait avoir un impact considérable, exacerbant encore la pression sur les ressources hydrauliques. L’eau est plus que jamais une composante inévitable dans le calcul sécuritaire des États.
Le dessalement de l’eau de mer représente une solution de plus en plus accessible pour atténuer la pénurie d’eau et le stress hydro-politique. Bien que le dessalement à grande échelle reste encore bien souvent le privilège des pays à haut revenu, un nombre croissant d’États l’utilisent à moindre échelle plus ou moins intensément. Selon l’Agence internationale de l’énergie (AIE), d’ici à 2040, le dessalement devrait être 13 fois plus développé dans les pays du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord qu’en 2014 afin de répondre à la demande croissante en eau (1). Grâce à la technologie, l’approvisionnement en eau ne dépend plus uniquement des sources d’eau douce naturelles. De plus, les incertitudes sont réduites en matière de quantité et de qualité de l’eau. En conséquence, certains États, comme Israël, l’Arabie saoudite, l’Australie, les Émirats arabes unis, l’Espagne et l’Algérie, ont développé un programme de dessalement à grande échelle. Les ressources hydrauliques n’étant plus limitées, les acteurs bénéficient d’une plus grande flexibilité dans la gestion de celles-ci.
Une technologie plurielle
Il existe actuellement deux techniques principales de dessalement de l’eau qui sont commercialement viables. D’une part, les technologies de dessalement thermique utilisent la chaleur pour vaporiser l’eau douce. D’autre part, les technologies membranaires (ou de filtrage) séparent l’eau douce de l’eau de mer ou de l’eau saumâtre (2) à travers une membrane. Aujourd’hui, les procédés de dessalement les plus répandus dans le monde sont principalement basés sur l’osmose inverse (60,0 %) – une technologie membranaire – et les techniques Multi Stage Flash (26,8 %) – une technologie thermique (3). La faisabilité de chaque procédé dépend de conditions spécifiques telles que la qualité ou le type d’eau, le prix de l’énergie et les ressources techniques du pays ou de la région où l’usine est construite.
La plupart des techniques de dessalement sont alimentées au pétrole ou au gaz naturel, entraînant des coûts énergétiques élevés. Bien que la consommation d’énergie de la technique d’osmose inverse soit inférieure à celle des techniques thermiques, la construction d’usines de dessalement d’osmose inverse nécessite des investissements financiers initiaux importants. Par conséquent, le dessalement à grande échelle est encore essentiellement assuré par les pays à haut revenu qui sont en mesure de prendre en charge les coûts de ces installations. Néanmoins, de petites usines de dessalement, parfois à un niveau très local, sont mises en place et utilisées pour fournir de l’eau à quelques ménages ou communautés dans les pays à faible ou moyen revenu. Par exemple, une grande partie des usines de dessalement de la région des Caraïbes utilisent le processus d’osmose inverse (4). Des installations de dessalement à moyenne échelle sont également implantées au niveau régional ou municipal dans des pays tels que la Jordanie ou l’Égypte.
De nombreux challenges
Le dessalement est confronté à plusieurs défis, notamment financiers et environnementaux, qui sont susceptibles d’augmenter en nombre et en diversité au fur et à mesure que la technologie se généralise. La nature de ces défis peut varier selon le pays, le contexte régional et les caractéristiques de l’eau d’alimentation. Trois éléments différents font varier le coût de l’eau dessalée : le type d’eau d’alimentation (eau de mer ou eau saumâtre), la source d’énergie et la taille de l’usine. Des trois, le coût de la source d’énergie a la plus grande influence sur le coût du processus. Par conséquent, la faisabilité économique de la construction d’une usine de dessalement dépend en grande partie de la disponibilité énergétique locale ou du coût de l’énergie.
Par ailleurs, malgré le besoin urgent de solutions alternatives aux sources d’eau naturelles, la forte consommation d’énergie de la technologie, les émissions de CO2 et la question du rejet des déchets liquides (la saumure) poussent certains experts à mettre en garde contre le dessalement. Bien que le dessalement par osmose inverse soit présenté par ses défenseurs comme moins énergivore et moins coûteux que le dessalement thermique, l’augmentation de la capacité de dessalement mondiale nécessite la mise en place de solutions durables en matière de recyclage et d’élimination de la saumure afin de limiter la dégradation de l’environnement.
Dessalement et énergie renouvelable
Jusqu’à récemment, la plupart des usines de dessalement se situaient là où les sources d’énergie fossile étaient disponibles en quantité significative et à un prix très bas, avec seulement 1 % du dessalement mondial alimenté par des sources d’énergie renouvelable. Néanmoins, ces dernières, telles que l’énergie solaire photovoltaïque ou l’énergie éolienne, deviennent une alternative de plus en plus attrayante pour les pays importateurs d’énergie tels que l’Inde ou la Chine, où la demande de dessalement est en hausse. La mise en œuvre de ces différentes technologies dépend bien évidemment des sources d’énergie disponibles localement. Par exemple, les régions arides et semi-arides possèdent de larges sources d’énergie solaire tandis que les communautés côtières et insulaires bénéficient d’importantes sources d’énergie éolienne. De plus, l’utilisation de ces sources d’énergie alternatives rend le processus de dessalement plus compétitif et plus respectueux de l’environnement.
Au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, une région caractérisée par une forte inégalité en matière d’accès aux sources d’hydrocarbures, certains pays, en particulier les pays du Golfe, peuvent compter sur ces sources fossiles pour alimenter des usines de dessalement à grande échelle (5). Or, la région bénéficie également d’une forte exposition au soleil et de larges espaces désertiques, transformant celle-ci en un lieu approprié pour les usines de dessalement à énergie solaire où la potentialité par kilomètre carré équivaut à l’énergie produite par 1 à 2 millions de barils de pétrole (6). Jusqu’à présent, cette alternative aux énergies fossiles reste coûteuse, même si des progrès technologiques sont réalisés afin d’en réduire les coûts. De nos jours, l’Arabie saoudite, l’Inde, le Brésil, Chypre, l’Égypte, la Jordanie, la Turquie et d’autres pays mettent en place des usines de dessalement alimentées par des énergies renouvelables. Malgré le recours croissant à ces sources d’énergies alternatives, leur utilisation implique de nombreux problèmes techniques, économiques et organisationnels qui empêchent actuellement de créer un approvisionnement énergétique constant. De larges sources à faible coût et des technologies de stockage performantes sont nécessaires pour atténuer la nature variable des énergies renouvelables.
L’eau dessalée, un enjeu stratégique national et régional
Le dessalement d’eau de mer à grande échelle peut potentiellement modifier l’approvisionnement en eau de certaines régions côtières. En créant de nouvelles sources d’eau douce, il peut avoir un impact positif au niveau économique, politique et social d’un État. Néanmoins, sur le plan environnemental et au niveau de la coopération régionale ou internationale, cela demande des recherches supplémentaires. Alors que les acteurs engagés dans le domaine de la gestion de l’eau s’accordent à dire qu’il faut rendre la technologie plus accessible, il est évident que ces technologies ne remplacent pas la volonté politique, condition sine qua non pour la mise en place de solutions de gestion hydraulique durables qui, développées de manière appropriée, peuvent contribuer à renforcer la sécurité hydraulique des États.
Dans un contexte de tensions hydrauliques transfrontalières, le dessalement pourrait également changer la donne dans les années à venir. En réduisant le stress hydro-politique, il pourrait promouvoir une coopération interétatique accrue. Mais en réduisant l’interdépendance entre les acteurs, une plus grande flexibilité au niveau de l’approvisionnement en eau pourrait au contraire diminuer l’incitation à conclure des accords de gestion conjointe des ressources naturelles transfrontalières. Les acteurs concernés pourraient ne pas coopérer et agir unilatéralement sur la part qu’ils considèrent comme leur. Ainsi, malgré certaines barrières économiques et environnementales au dessalement à grande échelle, la technologie pourrait modifier le pouvoir politique inhérent aux acteurs riverains en amont et réorganiser les fondements géopolitiques de l’eau.
Notes
(1) AEI, « Making freshwater from the sun », 30 janvier 2017.
(2) L’eau saumâtre – eau de lagune, d’étendues d’eau nées de la rupture d’une digue maritime… – a une teneur en sel sensiblement inférieure à l’eau de mer (moins de 10 grammes par litre pour la première, contre 35 g/l en moyenne pour la seconde), mais supérieure à l’eau douce, dont la salinité faible permet la consommation. [NdlR]
(3) IRENA, IEA-ETSAP, « Water desalination using renewable energy », Technology Brief I12, mars 2012.
(4) Caribbean Environmental Health Institute (CEHI), The Use of Desalination Plants in the Caribbean, Phi-VI/Documento Técnico n° 5, Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), Montevideo, 2006.
(5) Greenlee et al., « Reverse osmosis desalination : Water sources, technology, and todays challenges », Water Research 43 (2009) 2317–2348, mai 2009.
(6) La Banque mondiale, « Renewable Energy Desalination : An Emerging Solution to close the Water Gap in the Middle East and North Africa », MENA Development Report, 2012.
(Article publié dans Les Grands Dossiers de Diplomatie n° 46 (Mers et océans. Géopolitique & géostratégie), Areion Group, août-septembre 2018)
Photo ci-dessus : Usine de dessalement à Hambourg, en Allemagne. (© Shutterstock/Andrea Izzotti)