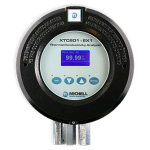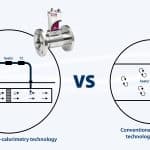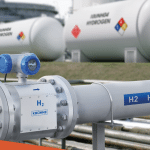Green Innovation. Peut-on dire que la propagation de la COVID-19 révèle une part de notre monde moderne, comme la mondialisation, l’hyperconnexion entre les continents, la multiplication des échanges ? En fait, qu’est-ce que ce virus dit de nous ?
Serge Morand. L’émergence du SARS-CoV‑2, issu d’un virus de chauves-souris ayant recombiné chez un hôte intermédiaire (potentiellement un pangolin) a conduit à une pandémie d’une nouvelle maladie infectieuse, la COVID-19. Ce lien entre un virus, une chauve-souris, un hôte intermédiaire, et la crise sanitaire exceptionnelle résultant de son émergence et de sa transmission à l’ensemble de la population humaine mondiale interpelle. Il est encore trop tôt pour expliquer l’émergence du SARS-CoV‑2 et de ses premières transmissions interhumaines, et encore moins pour expliquer pourquoi la ville de Wuhan a été le point de départ de la pandémie. Mais, dès que des chaînes de transmission interhumaine ont pu se mettre en place dans un « hub » de la mondialisation, alors tout était en place pour une pandémie.
La pandémie est une épidémie locale qui s’étend à l’échelle de la planète. Le constat est qu’il y a de plus en plus d’épidémies de maladies infectieuses ces dernières décennies et que ces épidémies se mondialisent de plus en plus depuis le début des années 1960. Le transport aérien de voyageurs ou de fret semble en être l’explication. Ainsi, le nombre total de passagers est passé d’environ 330 millions en 1970 à plus de 4 milliards en 2017 (1 100 % d’augmentation). Le volume total de fret aérien est passé de 15 milliards de tonnes par kilomètre parcouru en 1970 à un peu plus de 220 milliards en 2017 (une augmentation de plus de 1 300 %). La mondialisation des épidémies, ce que l’on pourrait nommer « pandémisation », est associée à l’augmentation du transport aérien.
La démographie humaine trouve également toute sa place en tant que facteur favorisant la propagation des maladies infectieuses. Non pas en reprenant un discours simplificateur ne considérant que le taux de croissance démographique ou de fécondité humaine, mais en soulignant l’importance d’une transition majeure dans l’histoire de l’humanité. Depuis le début des années 2010, plus de la moitié de la population mondiale vit dans les villes, et les projections donnent une population urbaine totale de plus de 5 milliards de personnes à l’horizon 2030. Ces centres urbains anciens et nouveaux sont interconnectés par un réseau en pleine expansion d’aéroports et de routes accélérant la circulation des personnes, des biens, et des agents infectieux.
Vous parliez dans une récente interview d’un moment clé dans les années 1990, c’est-à-dire la rencontre improbable entre une chauve-souris et un porc. Pouvez-vous nous expliquer cet épisode ?
L’émergence du SARS-CoV en 2002 est loin d’être parfaitement connue et il nous faut rechercher des exemples mieux renseignés d’émergence de virus hébergés par les chauves-souris. Celui du virus Nipah en Malaisie en 1998 est un bon exemple, car il illustre le lien entre émergence et changements locaux liés à l’insertion dans l’économie globale.
En septembre 1998, une épidémie se déclare dans des élevages de porcs en Malaisie péninsulaire. De nombreux animaux présentent des signes infectieux sévères et, peu après, les éleveurs souffrent à leur tour des mêmes signes infectieux. L’épidémie se propage ensuite aux abattoirs de Singapour avec l’importation de porcs infectés de Malaisie. Rapidement, les enquêtes épidémiologiques démontrent le rôle de chauves-souris, des roussettes frugivores, comme réservoirs de l’agent infectieux, le virus Nipah. Cette crise sanitaire se solde par le décès de 105 personnes sur les 265 qui ont été infectées par le virus et par l’abattage de plus d’un million de porcs afin d’enrayer l’épidémie.
Comment expliquer qu’un virus d’une chauve-souris ait pu se retrouver chez un porc d’élevage ? En cette année 1998, la grande île de Bornéo subit de nombreux feux de forêt d’origine anthropique, favorisés par une exceptionnelle sécheresse en raison d’un fort El Niño. À cette époque, l’île de Bornéo est déjà soumise à une importante déforestation afin de faire place aux plantations commerciales de palmiers à huile. Face à la réduction de leurs territoires, à la perte d’alimentation, aux fumées des feux, les roussettes sont parties à la recherche de nouvelles zones d’alimentation et de repos. Elles vont les trouver dans les plantations malaisiennes d’arbres fruitiers couvrant les élevages de porcs à destination du marché singapourien. La conversion des forêts tropicales de Bornéo en plantations de palmiers à huile pour le marché international a permis la mise en contact des chauves-souris avec des porcs, destinés eux aussi au marché international. Les chauves-souris ont transmis leurs virus aux humains, par l’intermédiaire des porcs d’élevage, en raison de l’altération de leur habitat originel et de leur nouvelle cohabitation avec des productions agricoles et animales dans un contexte de mondialisation des échanges agricoles.
Notre monde moderne ne détient-il pas également les solutions ? Comme les innovations technologiques dans le développement durable par exemple ? Et quelles sont nos perspectives ? Plus rien ne sera-t-il vraiment comme avant ?
La gestion des crises sanitaires devrait nous apprendre à être méfiants à propos des innovations technologiques. Les mesures exceptionnelles que sont le confinement, la quarantaine et l’abattage pour les animaux (sauvages ou de rente) s’accompagnent de mesures post-crise que sont la biosurveillance et la biosécurité. Pour l’élevage, ces mesures conduisent à renforcer l’élevage industriel, seul à même de supporter les coûts de biosécurité et de répondre aux exigences de la biosurveillance. La diversité des races génétiques locales en fait les frais, avec une disparition alarmante des races issues d’une domestication issue de la longue histoire de l’humanité depuis la naissance de l’agriculture. Seules les races industrielles sont capables de « survivre » aux conditions de confinement des mégafermes. En dépit de cette biosécurité, les mégafermes sont les incubateurs de nouvelles pandémies. Pensons à l’émergence du virus H1N1 responsable de la grippe nord-américaine issue d’une mégaferme de cette région en 2009.
Il nous faut donc travailler sur les causes et non proposer des remèdes qui ne s’y attaquent pas. Il faut agir sur le local, les facteurs d’émergence, et sur le global, les facteurs de mondialisation des épidémies. Les solutions innovantes nécessitent de repenser l’agriculture et l’élevage en les réinsérant dans le tissu local et comme une contribution au développement territorial. L’agroécologie, mais aussi l’écoforesterie et l’écopastoralisme peuvent contribuer à accroître la résilience des territoires face aux risques environnementaux, dont le dérèglement climatique, tout en assurant la sécurité alimentaire et sanitaire. Ce sont de nouvelles formes d’échanges entre les territoires et leurs environnements urbains proches qu’il s’agit de promouvoir grâce à l’économie circulaire. J’en appelle à une véritable « agroéconomie » circulaire à même d’enclencher la transition écologique souhaitable assurant la durabilité des ressources naturelles tout en contribuant au bien-être et à la santé de tous, humains et animaux. Les innovations seront aussi nombreuses que les territoires, les populations et les cultures de notre planète. C’est un appel à l’émergence d’une intelligence collective décentralisée.