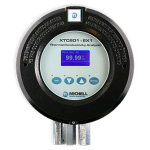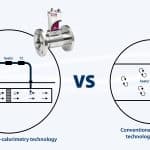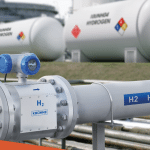Le secteur du bâtiment représente 30 % des émissions de CO2 de la France, en prenant en compte la fabrication des matériaux, la construction et l’habitation. Cela en fait un poste clé pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
L’amélioration de la performance énergétique des bâtiments est un levier incontournable de cette réduction. La future réglementation en la matière, la « RE2020 », apporte une évolution majeure en proposant de nouveaux indicateurs pour évaluer les impacts environnementaux du bâtiment sur l’ensemble de son cycle de vie.
Les particules végétales, des atouts pour l’isolation
Cette nouvelle approche devrait encourager les filières de matériaux qui émettent peu de gaz à effet de serre, comme les « isolants naturels ». Provenant de plantes, ce sont de véritables puits de carbone, en plus d’être compostables en fin de vie. Plusieurs sources de ces isolants sont disponibles en France à travers tout le territoire et toute l’année, permettant potentiellement d’assurer une disponibilité locale, réduisant fortement le coût écologique lié au transport.
La propriété recherchée lors de l’incorporation de particules végétales dans des matériaux biosourcés destinés au bâtiment est en premier lieu l’isolation thermique. Cette dernière est le résultat de la très grande porosité naturelle des agroressources. Cette porosité permet d’emprisonner de l’air, naturellement isolant. Les parois des particules végétales sont composées de polymères hydrophiles. Ces polymères peuvent donc servir de liant, un atout pour la conception de certains matériaux. Les applications possibles en écoconstruction des particules varient donc en fonction de leur biochimie et leur microstructure.
La France, terre d’agroressources
Répondre aux défis de construire et de rénover des bâtiments avec des matériaux de construction biosourcés va nécessiter des quantités gigantesques de ressources végétales et des plantes aux propriétés variées. Fort heureusement, ces sources sont nombreuses et potentiellement importantes. La grande majorité de ces agroressources provient de cultures annuelles et notamment de leurs tiges végétales. Les options sont très nombreuses : tournesol, colza, maïs, blé, orge, avoine, seigle, chanvre, riz, miscanthus, roseau sont tous explorés pour des utilisations en écoconstruction.
Historiquement en France, les premières particules végétales identifiées pour la fabrication d’« agrobétons » sont les coproduits issus du défibrage des tiges de chanvre. Les cultures de chanvre et de lin textile visent principalement à produire des fibres. Le défibrage des tiges de ces plantes produit des particules végétales appelées anas de lin pour la tige de lin et chènevottes pour la tige de chanvre.
Il existe d’autres cultures à fort potentiel sur le sol français. Par exemple, le miscanthus, ou « herbe à éléphant », implanté pour produire de la biomasse en vue d’une valorisation en bioénergie, a un rendement intense, de 15 à 20 tonnes par hectare et par an. Le broyage de la tige de miscanthus produit un seul type de particules végétales qui pourraient être aussi utilisées en écoconstruction.
Arbitrer entre plusieurs applications
Le total des différents gisements annuels recensés sur le territoire français peut être estimé à potentiellement plus de 15 millions de tonnes de ces particules végétales. Ce chiffre comprend les particules ayant déjà des voies de valorisation, telles que le paillage horticole, la litière animale, la bioénergie.
Concernant les tiges non récoltées aujourd’hui (tournesol, colza, maïs, une partie des céréales), il est nécessaire de prendre en compte le besoin agronomique du sol et de prévoir d’y laisser de la biomasse. Laisser la moitié permettrait de s’affranchir des dangers agronomiques.
S’il y a compétition entre ces différentes applications, le gisement annuel est tellement gigantesque que toutes les voies de valorisation utilisant des particules végétales pourront être fournies sans crainte de concurrence.
Une complémentarité géographique…
Les cultures du chanvre et du miscanthus proposent des surfaces limitées, mais promettent d’être implantées sur tout le territoire. Les cultures de maïs et de céréales couvrent pratiquement tout le territoire français, avec des répartitions plus ou moins homogènes selon les régions. Les autres cultures considérées ont des territoires précis.
On remarque une complémentarité de ces zones, laissant apercevoir que l’ensemble du territoire français peut être couvert pour les gisements de particules végétales provenant des différentes cultures. La valorisation locale des particules peut ainsi être envisagée, ce qui permettrait de limiter l’empreinte carbone liée au transport de ces matières légères et volumineuses.
… et temporelle
La plupart des cultures considérées sont des cultures annuelles, c’est-à-dire que la récolte se réalise une fois par an, à un moment précis de l’année.
Il apparaît que la diversité des cultures et donc les différentes périodes de récolte associées permettent une complémentarité temporelle assurant une disponibilité de matière végétale tout au long de l’année. Elle permet d’éviter des contraintes liées à des stockages longs.
Issues de la nature, les particules végétales présentent inévitablement des propriétés variables, mais étant donné la multitude de cahiers des charges des matériaux biosourcés pour la construction, la diversité et la complexité des particules végétales deviennent alors sources de potentialités.
Légende de la photo ci-dessus : Faire pousser des isolants thermiques, c’est possible. Ici, moisson de miscanthus, aussi utilisé pour les biocarburants. David Wright, Flickr, CC BY