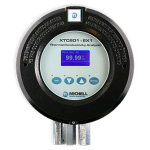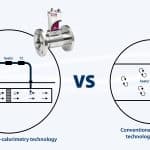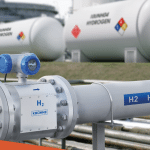En parallèle aux gisements de déchets agricoles, les biodéchets des ménages constituent une source potentielle importante pour la méthanisation, avec près de 5 millions de tonnes par an. Les dernières réglementations fixent des objectifs ambitieux de réduction, de réemploi et de valorisation de ces déchets, notamment pour les collectivités. Comment optimiser une production de biogaz via les biodéchets ? Le guide « Biodéchets : du tri à la source jusqu’à la méthanisation » proposé par GRDF donne des éléments de réponse.
Fini l’incinération, les déchets organiques peuvent être bien plus utiles, pour faire du compost, mais aussi pour la production de biogaz. À l’heure où l’énergie se fait plus rare, les collectivités doivent saisir l’occasion de mobiliser leur population pour la production de gaz pour une consommation locale. Mais la collecte et le déconditionnement restent à réinventer pour un retour au sol des sous-produits. Je trie, je me chauffe aussi !
Un gisement à trier
Quatre-vingt trois kilos par habitant ! Telle est la production annuelle de déchets organiques qui peuvent faire l’objet d’une valorisation par compost ou méthanisation, soit le tiers d’une poubelle d’ordures ménagères résiduelles (OMR). Pour donner un ordre d’idée, 1 000 tonnes de déchets peuvent produire 1,1 GWh/an soit suffisamment pour 4 bus roulant au GNV ou pour 275 foyers alimentés au gaz vert pendant un an ! Jusqu’ici, enfouissement et incinération, parfois à de longues distances, constituaient le devenir de beaucoup de déchets. Un gaspillage qui ne sera plus autorisé. À partir du 1er janvier 2024, tous les producteurs de biodéchets devront disposer d’une solution qui leur permettra de réaliser un vrai tri à la source, afin de pouvoir utiliser ces biodéchets en compost ou en méthanisation pour fournir énergie et engrais. Mais la loi, si elle fixe des objectifs, ne donne pas, n’impose pas les solutions pour y parvenir.
La loi et l’intérêt économique
Comme le rappelle le guide « Biodéchets : du tri à la source jusqu’à la méthanisation » financé par GRDF, les dernières lois françaises, qui modifient le Code de l’environnement, fixent des objectifs ambitieux sur la prévention et la gestion des déchets avec entre autres :
• réduire de 15 % les déchets ménagers et assimilés (DMA) entre 2010 et 2030 (interdiction progressive des plastiques jetables, réduction des plastiques, réduction de moitié du gaspillage alimentaire…) ;
• développer le réemploi (créer un indice de réparabilité, allongement de la durée de vie des produits, création de nouvelles filières de réemploi…) ;
• augmenter la valorisation matière et organique (65 % de valorisation de déchets non dangereux en 2025).
Quoi qu’il en soit, il sera obligatoire pour tous de trier ses biodéchets à partir du 1er janvier 2024 ! D’ici au 31 décembre 2023, tous les producteurs de biodéchets doivent disposer d’une solution leur permettant de réaliser un tri à la source des biodéchets. Concernant les professionnels, l’obligation était effective depuis 2012 en fonction de leurs seuils de production. Depuis le 1er janvier 2016, les professionnels produisant plus de 10 t/an doivent trier et valoriser leurs biodéchets. Ce seuil sera abaissé à 5 t/an dès le 1er janvier 2023. Les producteurs doivent attester des quantités collectées et valorisées. Au 1er janvier 2024, tout le monde sera concerné : les ménages et les collectivités, les entreprises, les établissements de santé, les restaurants, etc.
Cependant, les collectes séparées des biodéchets ne sont pas une obligation. Le tri à la source des biodéchets peut aussi se faire via des solutions de proximité (compostage individuel, compostage en pied d’immeuble, de quartier), seules ou en complémentarité avec des collectes séparées. Quelles que soient la solution ou les solutions retenues, producteurs ou autorités compétentes de la gestion de ces déchets doivent être en mesure de justifier de l’efficacité de ce tri à la source. Mais l’objectif et l’aiguillon pour les collectivités va être aussi de réduire les coûts. Compost et méthanisation sont deux voies royales pour cela.
Précieux biodéchets
En effet, comme le rappelle le guide, les biodéchets ont une forte valeur agronomique. Ils sont facilement valorisables par retour au sol sous forme d’engrais naturels, réduisant ainsi l’utilisation d’engrais chimiques et contribuant à la maîtrise de ressources rares, comme le phosphore par exemple. Ils peuvent produire aussi de l’énergie par méthanisation.
Part non négligeable de notre poubelle, ces déchets ont une forte teneur en eau, et leur incinération ou leur enfouissement n’est pertinent ni écologiquement ni économiquement. Leur tri et leur valorisation permettent de réduire les impacts liés à la gestion des déchets (émission de gaz à effet de serre, de poussière, de lixiviats liés au stockage ou à l’incinération des ordures ménagères). Ils peuvent être un levier de maîtrise des coûts des collectivités face à l’augmentation attendue des coûts de traitement des OMR (augmentation de la TGAP, réduction des capacités de stockage et des exutoires).
Par leur composition, leur valeur énergétique et leur dégradabilité, ce sont des déchets mobilisables localement (dans un rayon de 50 km environ), qui favorisent ainsi une économie circulaire de proximité. Orienter les biodéchets en méthanisation contribue à une gestion circulaire de ces flux, au profit de logiques territoriales durables par production d’énergie renouvelable et par la valorisation des déchets produits localement. Le lien urbain-rural qu’implique le fléchage de ces biodéchets vers la méthanisation agricole, la diversification des revenus agricoles qu’elle permet ainsi que la dynamique entre acteurs du territoire qu’elle suscite inscrivent la méthanisation des biodéchets comme une réelle opportunité à développer. Nos biodéchets peuvent donc servir à nous transporter et à nous chauffer tout en participant à notre alimentation locale.
La méthanisation : outil de l’économie circulaire
En plus d’être une filière de production d’énergie, la méthanisation permet d’assurer plusieurs fonctions : gestion des déchets organiques et résidus agricoles, production de digestats valorisables comme fertilisants. Ces dernières années, parallèlement au développement de la méthanisation en France, plusieurs programmes ont été réalisés dans l’objectif de quantifier les gaz à effets de serre (GES) et de mesurer l’impact de la filière sur l’environnement, notamment via des analyses de cycle de vie (ACV) : ACV du biométhane, ACV de la méthanisation sur les exploitations laitières (IDELE), analyse GES selon la Directive européenne sur les énergies renouvelables (« RED II ») ou pour le Label Bas Carbone. Ces analyses montrent qu’en ce qui concerne le bilan GES et l’impact sur le changement climatique, la production et la valorisation de biogaz sont bénéfiques par rapport à un système de référence. C’est également le cas pour une majorité des autres impacts environnementaux.
Tout au long de la chaîne de valeur, des émissions de GES sont générées, quel que soit le type de traitement des biodéchets. En effet, différentes étapes peuvent être à l’origine d’émissions : lors du procédé lui-même, lors de la phase de stockage des matières sortantes, mais également lors de l’exutoire final (le retour au sol pour la méthanisation et le compostage, les installations de stockage de déchets dangereux – ISDD – pour l’incinération). Les procédés peuvent être également à l’origine d’émissions évitées, voire de stockage de carbone. Les émissions évitées sont comptabilisées dès lors qu’il y a production d’énergie (cas de la méthanisation et de l’incinération) en substitution à la consommation d’énergie fossile ou du fait de la substitution à l’utilisation d’engrais minéraux (cas de la méthanisation et du compostage). Enfin, le stockage du carbone est occasionné par le retour sur les sols agricoles d’un produit concentré en carbone stable, cas du digestat et du compost.
Importance du tri
Méthanisation et compostage centralisé sont les deux modes de valorisation organique des déchets alimentaires collectés en grandes quantités. La méthanisation permet d’ouvrir la voie de la valorisation énergétique en plus de la valorisation organique. La difficulté de la méthanisation et du compost par rapport à l’enfouissement et à l’incinération réside dans le tri et le déconditionnement, puis l’hygiénisation des biodéchets. Car ces solutions produisent un sous-produit (compost ou digestat) qui peut être utilisé dans le sol ultérieurement comme engrais, à condition que la quantité de polluants soit extrêmement faible. Étape intermédiaire avant le retour au sol, l’unité de méthanisation, à l’instar de la plate-forme de compostage, doit mettre tout en œuvre pour qu’à l’issue du traitement, la production finale, digestat ou compost, puisse être valorisée sur les terres agricoles. Les réactions biologiques qui s’opèrent au sein de l’unité de méthanisation n’exercent aucun pouvoir sur des résidus de plastiques, de métaux ou autres inertes qui n’ont aucune valeur agronomique (au contraire). C’est donc en amont du traitement que se trouvent les clés de la réussite de la valorisation par retour au sol de ces biodéchets, en conformité avec les objectifs réglementaires. Sensibilisation, techniques de collecte et de prétraitement sont des étapes essentielles à maîtriser et à déployer sur le territoire pour garantir la valorisation matière.
Les enjeux du tri des biodéchets sont nombreux. Un bon tri peut être aussi un levier de maîtrise des coûts de collectivités. En effet, la TGAP va augmenter jusqu’à 2025 selon la loi de finances, en passant de 30 € à 65 €/t pour le stockage entre 2021 et 2025 et de 8 € à 15 € pour l’incinération. Avec un bon tri, au lieu d’être une charge, les biodéchets peuvent se transformer en énergie et en engrais : deux produits et donc deux recettes permettant de diminuer le coût de traitement, de plus en plus élevé. L’intérêt est de les mobiliser localement sur des rayons de 50 km maximum, ce qui permet de créer une économie circulaire de proximité, avec des emplois à la clé dans une logique territoriale durable.
Déconditionnement : une étape nécessaire
Le déconditionnement est l’étape qui consiste à séparer la matière organique des emballages. Ces deux produits (soupe organique et emballages) vont pouvoir ainsi être valorisés de manière indépendante et optimale et éviter incinération ou enfouissement. Il ouvre la possibilité à de nombreux producteurs de biodéchets (collectivité, GMS, restaurants, etc.) de les recycler de manière optimale et de participer à un retour au sol de la matière organique. Mais la qualité de la soupe postdéconditionnement est nécessaire pour cela. Parmi les exigences de la nouvelle rubrique ICPE, tout plastique, verre, métal supérieur à 2 mm et toutes concentrations de ces matériaux au-delà de 0,3 % excluront le retour au sol.
On retrouve trois principales technologies :
• broyage/séparation : la séparation se fait lors du broyage. Il s’agit de la technologie la plus répandue, notamment pour les petites capacités ;
• compression : la séparation se fait après broyage par un équipement compresseur ;
• hydromécanique : la séparation se fait après ou pendant le broyage dans un pulpeur. C’est la technologie la moins répandue en France.
Hygiénisation : obligation réglementaire
Les biodéchets des ménages et des professionnels de la restauration sont des déchets de cuisine et de table (DCT) et sont également classés comme des sous-produits animaux (SPAn) de catégorie 3. Ils sont donc nécessairement hygiénisés avant d’être introduits dans le méthaniseur. Cette étape peut intervenir sur site ou hors site. Les équipements d’hygiénisation sont des cuves inox thermorégulées précédées d’un broyeur à maille fine. L’énergie utilisée pour la montée en température peut être soit le biogaz, soit une autre énergie renouvelable, soit une énergie fossile. Le dossier d’agrément est instruit par la DDCSPP (Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations) du territoire et doit contenir la description du site (équipements, fonctionnement), le plan de maîtrise sanitaire (avec étude HACCP29.) et la gestion de la traçabilité et des lots non conformes. Une inspection sur site est réalisée avant la remise de l’agrément provisoire de trois mois pour le début de l’activité. C’est un dossier évolutif qui fait l’objet d’inspections régulières.
Agrément des sites
Les sites de méthanisation accueillant des sous-produits animaux (SPAn) doivent obtenir un agrément pour lequel les déchets doivent être :
• traités rapidement après réception sur le site (< 24 h) ;
• broyés pour obtenir une taille des particules à l’entrée < 12 mm ;
• hygiénisés, c’est-à-dire maintenus à 70 °C pendant 1 h consécutive avec enregistrement en continu de la température.
Les véhicules et conteneurs utilisés pour le transport des SPAn doivent être :
• propres et secs avant utilisation ;
• nettoyés après chaque utilisation (ceci concerne les parties ayant été en contact avec des SPAn et les roues des véhicules).
ICPE
Les plates-formes de compostage (recevant 2 tonnes/jour ou plus de déchets) et les unités de méthanisation relèvent toutes deux des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE). Elles doivent répondre à des prescriptions variables selon la typologie et la quantité de matières entrantes/traitées. Elles font l’objet d’une démarche d’analyse des dangers. La présence de déchets carnés ou de poissons (ce sont des sous-produits animaux de catégorie 3 – appelés SPAn 3) nécessite que ces unités disposent d’un agrément sanitaire, et soient aménagées en conséquence (revêtement, nettoyage, récupération des eaux, etc.). Leur stockage sur site est donc circonscrit, et les déchets tracés.
TGAP
Le coût de traitement des ordures ménagères (OMR) résiduelles va augmenter. En effet, la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) s’applique notamment sur les coûts de traitement des ordures ménagères enfouies ou incinérées. Or la loi de finances 2019 prévoit son augmentation jusqu’en 2025 pour inciter le tri, la valorisation matière ou organique des déchets et faire ainsi évoluer les pratiques et les comportements. De 2021 à 2025, elle passera de 30 € à 65 €/t pour le stockage et de 8 € à 15 €/t pour l’incinération. Cela peut représenter jusqu’à 30 % d’augmentation sur le seul poste de coût de traitement des OMR. Notons que le traitement des biodéchets n’est pas assujetti à cette taxe.