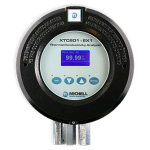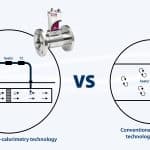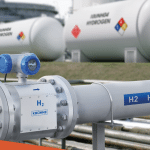Financer une unité de production de biogaz, entre tarifs en baisse et Capex et Opex en hausse, demande aujourd’hui une préparation hors pair de son projet et une connaissance des différents acteurs. Suivez le guide « Financement de la méthanisation » de l’Ademe.
Comme le rappelait Nicolas Hubert, chargé du développement biométhane chez GRDF, lors d’un webinaire récent, la part du financement des unités de méthanisation a évolué. « Il y a quelques années, on était sur un schéma 10 % de fonds propres, 20 % de subventions et 70 % d’emprunt. Aujourd’hui, les subventions ont fondu et le fonds propre doit toujours être d’un minimum de 10 %, mais avec des tiers financeurs de 5 à 15 % en plus pour un endettement maximum de 75 %. Si les financeurs regardent le prévisionnel, ils sont aussi très attentifs aux porteurs de projets et à leur motivation : rentabilité, conviction, choix assumé de diversification… Le problème actuel est l’effet ciseau des tarifs en baisse et de l’inflation des Capex et Opex. En 2021, la rentabilité des unités de méthanisations tournait en moyenne autour de 6 à 7 %, difficile à atteindre en 2023. »
Proposer un projet viable et motivé
Aujourd’hui, une optimisation de l’installation est impérative (voir aussi notre dossier optimisation dans ce numéro). Certains projets voient leur financement compromis. Il est donc plus que jamais important de présenter un projet qui prend en compte tous les aspects rendement de la production de gaz mais aussi les sous-produits, l’économie de coût de fonctionnement, l’autonomie maximum en intrant ou en énergie… Il convient aussi de frapper à toutes les portes pour compléter parfois un plan de financement. Enfin, pour une acceptabilité locale, qui évite de longs retards très coûteux, il peut être intéressant d’envisager un financement participatif.
Il existe plusieurs guides pour aider les porteurs de projet en matière de financements. Citons le « Guide pour le financement de la méthanisation de l’ADEME » ou encore « Financer un projet de méthanisation » de GRDF que nous évoquons dans ce dossier. À noter également « Financer un projet de méthanisation », un guide de conseils proposé par AILE et Rhône-Alpes Energie Environnement, et « Pourquoi et comment intégrer le financement participatif ? » proposé par de nombreux acteurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes et qui évoque au-delà du financement l’aspect acceptabilité des projets dans le territoire.
Choisir le bon financement
Un projet de méthanisation représente un investissement financier important – entre 1 et 6 millions d’euros, voire plus. Les porteurs de projets empruntent la majorité des fonds nécessaires auprès des banques (entre 70 et 80 %). Pour les 20 à 30 % restants, il leur faudra mobiliser d’autres sources de financement. Certains organismes comme l’ADEME, les collectivités ou les régions, peuvent apporter des subventions. Néanmoins, les agriculteurs pourront avoir recours à quatre grands types de financements complémentaires comme le financement participatif, les fonds privés, les fonds mixtes, le prêt sans sûreté. Ces produits présentent chacun leurs avantages mais nécessitent également quelques points d’attention. Ils sont plus ou moins attractifs et adaptés en fonction des caractéristiques du projet.
Dans certains cas, de nouveaux investisseurs seront associés à la gouvernance du projet. Si cela peut être perçu comme une dilution du pouvoir de décision des associés, ces types de financement présentent des avantages extra-financiers tels que l’apport de connaissances, de compétences et une meilleure intégration territoriale. Dans le « Guide pour le financement de la méthanisation », GRDF recense les solutions de financement pour les projets de méthanisation agricole et propose aussi les noms des sociétés de financement dans chaque domaine. Synthèse de vos « amis financiers ».
Le financement bancaire
Les banques sont les partenaires classiques pour financer les projets et représentent déjà une large part (60 à 70 %) du financement. Cette part pourrait devenir encore plus importante à l’avenir, avec la maîtrise des coûts de la filière et la labellisation des matériels, des fournisseurs et des prestataires (Qualimétha). Le financement bancaire s’inscrit dans une durée voisine de celle du projet. Dans le cadre d’un financement de projet d’unité de méthanisation, la dette bancaire est la base du plan de financement, qui décrit les ressources financières permettant de financer les emplois : CAPEX, TVA, intérêts de construction, comptes de réserve, etc.
Les avantages de la dette bancaire sont les suivants :
- elle soulage la capacité financière des exploitations agricoles dont les fonds propres sont limités,
- elle contribue à l’effet de levier qui permet d’optimiser les flux actionnaires et ainsi d’augmenter la rentabilité financière du projet.
Toutefois, les conditions d’accès à la dette sont assez strictes dès lors qu’il s’agit d’un financement sans recours (sans sûreté), c’est-à-dire sans majeure caution des emprunteurs, telle qu’une garantie des actionnaires permettant de déconsolider l’actif de leur bilan. Avec l’appui du ministère de l’Agriculture et de l’ADEME, BPI France propose des prêts sans garantie pour développer la méthanisation avec cogénération ou injection, à base principale de matières agricoles. « Sans garantie » signifie qu’aucune « sûreté » n’est demandée sur les actifs de la société, ni sur le patrimoine des dirigeants. Ces prêts peuvent s’étaler sur 12 ans et comprendre un différé de remboursement du capital de 2 ans en général.
Le financement participatif
Le financement participatif est parfois appelé « financement citoyen » ou encore « crowdfunding ». Il s’agit d’un prêt, assimilé à des quasi-fonds propres sur une durée relativement courte (3–5 ans) par rapport à la durée du projet. Les fonds alloués doivent être remboursés ou refinancés à l’échéance du prêt. Le financement participatif est une opportunité pour ancrer le projet dans son environnement local. Les plateformes participatives ont connu un véritable essor depuis quelques années, et la réglementation associée a largement évolué en faveur de leur développement. Ces plateformes permettent de collecter des fonds principalement auprès des particuliers et permettent d’améliorer l’acceptabilité locale des projets. Parfois, les résidents de la commune d’un projet peuvent bénéficier de conditions financières plus avantageuses que les autres investisseurs particuliers.
• Le financement est de type quasi-fonds propres : aucune caution ni garantie personnelle
• Il n’y a pas de prise de participation dans le capital de la société de projet
• Le projet bénéficie d’un apport de crédibilité supplémentaire en respectant les critères d’acceptation de la plateforme participative
• La durée maximale de collecte des fonds est fixée dès le départ, ce qui permet de bien tenir les délais du montage financier
• Le renforcement de l’appropriation locale du projet
• Les collectes de fonds sont généralement organisées via un ciblage géographique pour impliquer en priorité le territoire concerné par le projet
• La plateforme participative fait bénéficier le projet de son réseau de communication étendu et de son audience locale
• La plateforme permet de mixer différents profils d’investisseurs : citoyens, personnes morales, personnes publiques…
Les conditions financières sont toujours spécifiques à chaque projet toutefois, à ce jour le marché est le suivant :
• Le panier moyen est compris de 0,5 à 3 M€ avec un maximal légal de 6 M€ (exceptionnellement de 8 M€ en 2020)
• Le profil de remboursement est de type constant ou in fine avec un taux pratiqué de 4 à 6 % par an et une durée courte de 3 à 5 ans
• Les frais d’administration liés aux plateformes représentent 3 à 4 % des fonds collectés et les frais de gestion annuels représentent environ 1 % du capital restant dû.
Attention toutefois, le panier moyen proposé par les plateformes de financement participatif est généralement inférieur au maximum autorisé par l’administration. Par ailleurs, le remboursement étant prévu sur une maturité assez courte, cet outil de financement ne peut à lui seul compléter le tour de table complémentaire en matière de fonds propres.
Le financement par des fonds privés
Les fonds privés peuvent intervenir aussi bien par prise de parts sociales, en fonds propres ou quasi-fonds propres, que sous forme de dette. Ils peuvent se manifester sous plusieurs formats, dont la durée de maturité varie entre 5 et 15 ans. Il s’agit d’un financement très modulable dans son type d’intervention mais qui peut se traduire par des exigences financières très fortes (comme des taux d’intérêt élevés).
Par leur diversité dans les modes d’intervention, les fonds privés forment une offre diversifiée de fonds propres dans le financement de la méthanisation. L’ensemble des possibilités pourra également être étudié, et selon les compétences financières, au travers d’un conseil financier spécialisé. Les tickets d’investissements sont de 200 k€ à 20 M€. Il faut également retenir la capacité des fonds privés à intervenir sur les sociétés de projet, mais également sur l’environnement global du secteur de la méthanisation (constructeurs clé en main, fournisseurs d’équipements, etc.).
Les différentes typologies d’intervention :
- Les parts sociales = participation dans la société au travers de capital social et de comptes courants d’associés (CCA)
- Les OC (obligations convertibles = produit hybride entre la dette et le capital) avec faculté de transformation en action en cas d’OCA, c’est-à-dire une possibilité de détention du projet
- Le bridge = solution de financement court terme, sans détention de capital
- La mezzanine = solution de financement intermédiaire, se situant entre les fonds propres et la dette bancaire, subordonnée au remboursement de celle-ci.
Le financement par des sociétés d’économie mixte
Les sociétés d’économie mixte (SEM) sont des sociétés anonymes et représentent l’association d’investisseurs publics (détenant la majorité du capital) et d’acteurs privés. Il existe 2 formes différentes d’intervention de SEM en méthanisation : soit sous la forme d’une prise de participation au capital (SEM « investisseur »), soit sous la forme d’une société qui assure le portage du projet. En tant qu’investisseur, la SEM participe à l’ancrage du projet dans son territoire.
Les SEM ont 2 caractéristiques principales :
- L’ancrage est théoriquement local (bien que certaines SEM interviennent sur une échelle géographique élargie) ce qui répond bien au cadre de la méthanisation agricole
- L’activité associée peut être diverse : aménagement du territoire, construction, exploitation de services publics, etc.
Le financement par des syndicats d’énergie
Les syndicats d’énergie sont des structures départementales de regroupement de communes. Ils représentent l’autorité concédante du service public de l’énergie, usuellement dans la distribution de l’électricité et du gaz. À l’image des SEM, ces syndicats ont pour vocation de contrôler la bonne exécution du service public délégué par l’autorité délégante, dans l’intérêt général. Il est commun que les syndicats d’énergie soient propriétaires du réseau de gaz géré par les opérateurs de distribution de gaz naturel. Depuis la loi de 2015, les syndicats d’énergie ont la capacité juridique d’intervenir dans le capital des sociétés de projet.
Le financement par des fonds régionaux
Il s’agit d’entités créées à l’initiative des conseils régionaux pour répondre localement aux enjeux de la transition énergétique (efficacité énergétique, développement des ENR, etc.). Les fonds régionaux sont des sociétés de capital-risque, à statut de société de financement régionale, destinées à soutenir le développement des énergies renouvelables dans les régions. Ce type de fonds repose sur un partenariat entre la Région, d’autres acteurs tels que la Banque des Territoires (anciennement Caisse des Dépôts et Consignations) et des acteurs privés du territoire tels que des banques régionales. Ces fonds ont pour vocation à intervenir en prise de participation dans des projets d’énergie renouvelable incluant la méthanisation, lorsque celle-ci est présente sur un territoire.
Le financement par des collectivités
Les collectivités (régions ou intercommunalités par exemple) peuvent désormais prendre des participations dans les sociétés commerciales sans passer par décret en Conseil d’État. Le décret n° 2016–807 du 16 juin 2016 précise les conditions et les limites dans lesquelles le processus peut être réalisé. Il s’agit d’une demande de longue date, qui prend effet dans le cadre de la loi du 7 août 2014 portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République.
La loi NOTRe vient faciliter la prise de participation dans ces sociétés par les régions dans le cadre de leurs nouvelles compétences, et particulièrement dans le cadre de la mise en œuvre du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation dont elles sont responsables.
Les fonds publics
Les fonds publics proposent des solutions sur mesure de conseil et de financement en prêts et en investissement pour répondre aux besoins des collectivités locales, des organismes de logement social, des entreprises publiques locales et des professions juridiques. Ils s’adressent à tous les territoires, depuis les zones rurales jusqu’aux métropoles, avec l’ambition de lutter contre les inégalités sociales et les fractures territoriales.
Concernant le secteur de la méthanisation, l’intervention est composée d’une activité de conseil et de financement.
Initialement utilisée pour l’amorçage de nouvelles technologies, l’intervention de ces fonds tend à évoluer avec la maturité des filières avec par exemple des interventions en refinancement de fonds propres.
Le financement par des subventions
La subvention est le moyen classique d’intervention de la puissance publique pour aider une filière dans sa phase de développement. Elle vise à diminuer le coût des premières opérations et à produire du retour d’expérience (investissements d’apprentissage). Le montant des subventions peut se situer entre 10 et 25 % des coûts d’investissement, mais la tendance est toutefois à la baisse. Mais quelle que soit la méthode utilisée pour le calcul de l’aide, l’encadrement communautaire veut que le montant total des aides publiques ne dépasse pas 45 % des coûts admissibles pour les grandes entreprises, 55 % pour les moyennes entreprises et 65 % pour les petites entreprises au sens européen. Ces pourcentages ne sont jamais atteints en pratique. D’autant qu’une fois l’étape pionnière franchie, quand le nombre de projets devient élevé (phase de diffusion), la subvention devient moins pertinente, car elle s’avère lourde à traiter sur le plan administratif et, surtout, elle risque de maintenir artificiellement la cherté des prix sur le marché concurrentiel. À terme, la subvention a donc vocation à s’arrêter.
Dans le cas de la filière méthanisation, signalons qu’il existe déjà un tarif national d’achat qui assure ou doit assurer l’économie des projets. Les principales institutions publiques apportant des moyens de subventions sont exposées ci-après : ADEME, collectivités territoriales, Feder et Feader (fonds européens).