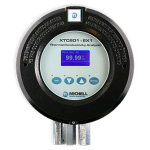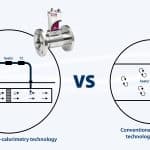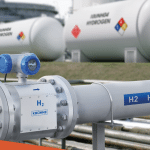Prix records à la pompe, 30 milliards de mesures de soutien au pouvoir d’achat en 2022 de la part de l’État, diminution de la fourniture en pétrole russe, manifestations de plusieurs professions face au risque de faillite… Le choc énergétique actuel est « comparable en intensité, en brutalité, au choc pétrolier de 1973 », a récemment déclaré le ministre de l’Économie.
En réalité, le coût de l’énergie augmente depuis plus d’un an avec la reprise de l’économie mondiale. Il est vrai que la hausse s’accélère nettement depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, deuxième producteur et deuxième exportateur mondial de brut.
Tout laisse à penser qu’il ne s’agit pas là d’un simple choc conjoncturel, mais bien de l’avant-goût d’une ère d’adaptation à la déplétion énergétique.
Tempérer les prix, ligne choisie par le gouvernement dans l’urgence, s’apparente à un pansement sur une jambe de bois : des mesures structurelles pour lutter contre la consommation d’énergies fossiles sont vitales. Parmi elles, la sobriété est essentielle pour baisser la consommation énergétique à court terme.
Les crises énergétiques révèlent la dépendance à la voiture
1973–1974 : au moment du premier choc pétrolier, les Pays-Bas, alors soumis à un embargo total de l’OPEP, encouragent les expérimentations en faveur du vélo.
À Tilburg, une ville moyenne du sud du pays, élus et services inaugurent une infrastructure cyclable de nouvelle génération, une piste matérialisée en rouge, donnant la priorité aux cyclistes, sans aucune coupure et avec peu d’arrêts.
L’infrastructure entraîna le renouveau de la pratique, devint une vitrine du savoir-faire néerlandais et s’exporta dans le reste du pays et à l’étranger.
Sans aller aussi loin, le ministère français de l’Équipement dépensa dans les années 1970 des dizaines des millions de francs pour subventionner dans plusieurs villes des aménagements cyclables. Cette politique, menée au titre des économies d’énergie, prit cependant fin dès le début des années 1980.
L’immense potentiel négligé du vélo
Cinq décennies plus tard, le déclin de la production mondiale du pétrole conventionnel est désormais initié, et l’Europe doit se préparer à un « risque de resserrement de l’offre » à l’horizon 2025. Un tarissement qui se produit pour le moment à un rythme trop lent pour protéger l’Europe des conséquences du dérèglement climatique.
Loin devant l’industrie, le secteur des transports est dans notre pays le plus émetteur de CO2 (31 % des émissions nationales). C’est aussi le seul dont les émissions augmentent en valeur absolue depuis plusieurs décennies, mais aussi du premier secteur en termes de consommation d’énergie.
La voiture est responsable à elle seule de 2 tonnes d’émissions de CO2 par an et par personne, ce qui représentera, si l’on se projette en 2050, le budget carbone total d’un individu pour atteindre l’objectif de neutralité carbone.
63 % des déplacements locaux sont effectués en voiture, seulement 9 % en transports en commun et un petit 2,7 % à vélo. La voiture reste très utilisée même pour des déplacements courts avec 60 % des déplacements domicile-travail de moins de 5 km (et encore 53 % pour ceux de moins de 2 km), distances parfaitement réalisables par une majorité de la population à pied et à vélo.
Ces distances ne sont pas l’apanage des citadins : les déplacements allant de 1 à 10 kilomètres représentent autour d’un trajet sur deux aussi bien en ville que dans les territoires ruraux. Contrairement à l’idée reçue, où que l’on vive, cette part reste ainsi assez similaire.
Le potentiel de report de la voiture vers le vélo est par conséquent assez homogène. Selon une étude du Cerema, la moitié de la population pourrait pédaler au quotidien (contre 3 % aujourd’hui). La part modale du vélo atteindrait alors 43 %. Sans atteindre un tel niveau (bien supérieur aux 28 % des Pays-Bas), on voit combien la marge de progression est considérable.
Ce potentiel est pourtant négligé. Si les Français possèdent près de 36 millions de vélos, plus de 10 millions dorment dans les caves et garages et ne sont jamais utilisés. Avec 3 % à 4 % des déplacements réalisés avec ce mode, la France reste encore loin de l’objectif d’atteindre 9 % en 2024, fixé par le plan national de 2018.
Tripler le nombre de pistes cyclables d’ici 2024
À court terme, les mesures réalistes et utiles pour faire évoluer cette situation restent nombreuses.
Le succès des territoires les plus cyclables réside largement dans la progression du nombre et de la qualité de l’infrastructure dédiée, la part modale du vélo ayant une relation linéaire avec le linéaire d’aménagements cyclables par habitant. Des réseaux cyclables permettant d’arriver à destination en toute sécurité pour tout un chacun sont un prérequis pour une pratique du vélo au quotidien dans toutes les couches de population, et pour l’augmentation de la portée des déplacements effectués à vélo (la distance parcourue est très faible en France).
Pallier l’absence de pistes cyclables est primordial, tant le manque de séparation entre véhicules motorisés et cyclistes peut entraîner un sentiment d’insécurité. Mais cela requiert un développement audacieux de l’infrastructure (dans des délais plus courts et à peu de frais). Aujourd’hui, il n’est pas rare de compter deux à cinq années pour qu’un aménagement cyclable soit effectivement réalisé entre les études préalables et la finalisation du chantier.
Les pistes temporaires sont une solution peu coûteuse, comme l’a montré la séquence des coronapistes après le premier confinement de 2020. En moins d’un an, de nombreux territoires se sont dotés d’environ 700 kilomètres de ces aménagements temporaires grâce à l’implication de l’État et des collectivités. Peu chères, réversibles, adaptables et rapides à installer, les coronapistes ont accéléré certaines politiques cyclables, mais ont aussi marqué la phase initiale de beaucoup d’autres. Elles ont fortement encouragé l’usage du vélo au quotidien. Des enseignements sont à tirer de ce succès, à la lumière des circonstances nouvelles.
Malgré les opportunités mises en avant par le Cerema, la plupart des boulevards urbains à 2x2 voies (voire 2x3 voies pour certains) n’ont pas connu de transformation ces deux dernières années.
Ils pourraient, dans les deux ans qui viennent, se voir dotés de pistes cyclables provisoires, à l’instar des axes où se polarisent les déplacements : ceux qui desservent les gares, les pôles intermodaux, les écoles, collèges, lycées et grands équipements publics, les quartiers d’affaires et les zones artisanales et commerciales qui en sont encore dépourvues.
Un programme systématique d’identification et de traitement des points noirs qui forment des véritables coupures pour les usagers – des carrefours complexes, des grands giratoires, des entrées d’agglomérations, des ponts – offrirait une continuité des itinéraires là où se concentrent les conflits potentiels entre usagers.
Allouer un milliard d’euros par an entre 2022 et 2024
Si, dans les métropoles, le vélo occupe déjà souvent une place visible, son développement dans les zones moins denses reste un défi.
En milieu rural et périurbain, entre les villes et les villages, des départementales actuellement hostiles aux cyclistes, mais pourvues d’accotements, pourraient accueillir des pistes bidirectionnelles offrant des liaisons directes et sûres entre villes et villages.
En l’absence de solution existante pour les cyclistes, le trafic motorisé de transit d’une route rurale fréquentée pourrait être reporté sur des axes plus adaptés afin de réaffecter cette route au vélo, aux riverains et aux véhicules autorisés. Le réseau très dense de voies en France est plutôt adapté à cette solution, simple et apportant des itinéraires sûrs et confortables aux cyclistes pour un coût dérisoire.
Le manque de moyens techniques et financiers dans les petites collectivités, rurales ou périurbaines, est un obstacle majeur à l’expérimentation et à la pérennisation de pistes cyclables, d’une manière équitable, sur l’ensemble du territoire.
Un budget exceptionnel de l’État d’un milliard d’euros par an entre 2022 et 2024, dédié au financement intégral des infrastructures, permettrait de donner un signal décisif aux collectivités locales, de recruter des ingénieurs et chargés de mission dédiés, et de tripler le réseau cyclable de 54 000 km à 150 000 km (au minimum, en partant d’un coût moyen d’un aménagement provisoire de 30 000 à 50 000 euros par km), et de traiter des centaines de coupures urbaines.
L’investissement en faveur du vélo atteindrait alors 15 €/habitant/an à l’échelle nationale, générant une forte intensité en emplois, beaucoup plus importante que celle du secteur automobile. Les départements, qui n’investissent que 3,75 €/habitant/an et comptent en moyenne moins de 3 agents en charge de la politique cyclable, doivent pour cela donner la priorité au vélo et réorienter les missions d’une partie de leurs agents jusqu’ici en charge des travaux et projets routiers.
Des plans pour limiter la circulation motorisée
Cette période est également une occasion de tester des plans de circulation et des rues ou zones à trafic limité, en particulier dans les centralités de quartiers et devant les écoles.
En effet, des véhicules motorisés en trop grand nombre et roulant trop rapidement excluent la marche et le vélo. Le Cerema a publié l’an dernier des recommandations pour faire connaître l’intérêt de cet outil très peu coûteux.
Avec l’adoption de la vitesse maximale à 30 km/h en agglomération (à l’exception de quelques axes), ces plans permettent de se déplacer sans encombre dans les villes et villages à pied et à vélo, en contraignant voire en interdisant la circulation motorisée de transit. Ils s’accompagnent idéalement d’une généralisation des double-sens cyclables dans toutes les rues à sens unique.
L’urgence de s’affranchir des énergies fossiles
Il faut ensuite accompagner différents publics à adopter ces pistes au quotidien. Le gouvernement pourrait rendre obligatoire le forfait mobilité durable, ce qui inciterait davantage les salariés des secteurs privé et public à privilégier les modes actifs pour se rendre au travail.
L’usage des vélos et des modes intermédiaires en substitution à la voiture peut rapidement se diffuser grâce à des aides dédiées d’urgence, modulées en fonction des situations financières et du degré de dépendance à la voiture.
Enfin, il est aussi possible d’organiser sans attendre des dimanches sans voiture, voire des week-ends, dans toutes les villes : ils donnent l’opportunité à tous de se réapproprier l’espace public largement occupé par l’automobile.
Bien sûr, l’ensemble des mesures doit être adapté aux caractéristiques et problématiques de mobilité de chaque territoire. Mais s’affranchir des énergies fossiles devient désormais une urgence sociale et géopolitique, en plus de représenter une opportunité pour favoriser le tournant vers une mobilité décarbonée.
Des milliers de kilomètres de pistes cyclables, édifiées en quelques mois, constitueraient un marqueur fondamental d’un ambitieux plan de résilience, tant le vélo porte une promesse d’accès universel, équitable et abordable à la mobilité.
En partenariat avec Theconversation.fr.