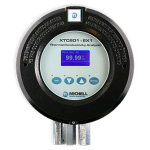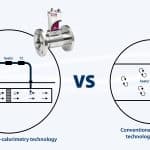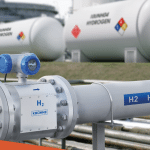On connaît moins bien le fond des océans terrestres que la surface des continents ou celle de la planète Mars. C’est pourtant au fond des mers, au niveau des dorsales – où les plaques tectoniques s’écartent –, qu’ont lieu les plus importants échanges entre la Terre profonde et les océans, de chaleur ou de magma entre autres, qui peuvent in fine se répercuter sur l’atmosphère.
Ces échanges affectent la chimie des océans et peuvent être associés à différents types d’écosystèmes dont la découverte ne cesse de progresser.
Pour mieux comprendre la topographie de ces zones sous-marines et leurs processus magmatiques, tectoniques et hydrothermaux, nous vous emmenons en campagne océanographique le long du massif sous-marin Rainbow, sur la dorsale médio-atlantique, au sud des Açores.
36 scientifiques et 30 marins, un sous-marin autonome et un robot télécommandé partent un mois en mer pour chercher des traces d’une activité hydrothermale de basse température diffuse sur l’ensemble du massif qui co-existerait avec les cheminées hydrothermales de haute température qui sont bien connues.
Les dorsales océaniques, lieux d’échange entre la Terre profonde, les océans, puis l’atmosphère
Longtemps considérés comme de mornes steppes, les fonds océaniques ont suscité un intérêt grandissant vers le milieu du XXe siècle lorsque les dorsales, ces reliefs qui sillonnent le milieu des océans sur plus de 65 000 kilomètres, ont été identifiées comme des zones volcaniques actives, où se développent des oasis de vie en conditions extrêmes. Les plaques tectoniques s’écartent au niveau des dorsales, ce qui provoque une remontée de magma ou de roches profondes sur le plancher océanique, et la formation de failles et de reliefs. L’eau de mer peut alors s’infiltrer en profondeur dans la roche et y interagir chimiquement avant de remonter à la surface sous l’effet de la chaleur. Les dorsales sont donc un extraordinaire lieu d’échange de chaleur et de matière entre la Terre profonde et les océans, puis l’atmosphère.
Les plus spectaculaires manifestations de ces interactions sont les cheminées hydrothermales qui relarguent des liquides et des gaz de haute température (jusqu’à 400 °C) dans l’océan. Mais d’autres types d’émanations, plus discrètes, plus froides, peuvent aussi avoir lieu et représenter une partie non négligeable, encore inestimée, des échanges thermiques et élémentaires. Les fluides hydrothermaux sont par exemple une source de fer vers l’océan, élément essentiel pour de nombreux organismes. Sous forme de méthane ou de dihydrogène, leur circulation est une source de carbone et d’énergie pour divers écosystèmes. Identifier la nature, la durée et l’étendue spatiale de ces échanges est fondamental pour une meilleure compréhension de leur impact sur la chimie des océans.
Comment explorer à plus de 2000 mètres de fond
Pour appréhender un tel système, en tant que géologues, nous avons besoin d’une bonne connaissance des reliefs (bathymétrie), d’observations directes sur le terrain, d’échantillons de roches et de fluides. L’accès au terrain passe donc par une campagne océanographique, avec la mise à disposition d’un navire dédié de la flotte océanographique française et toute une série d’engins embarqués qui donnent un accès direct ou indirect au plancher océanique.
Contrairement aux surfaces planétaires émergées, où la topographie est connue avec quelques centimètres de résolution – y compris sur d’autres corps planétaires comme Mars ou la Lune, la topographie des terres immergées est difficile à cartographier, la colonne d’eau empêchant une mesure directe des hauteurs.
Une première estimation peut être obtenue à l’aide de satellites (bathymétrie par altimétrie satellitaire) et de modèles mais la résolution d’environ 100 mètres est insuffisante pour une bonne analyse des processus géologiques. La mesure directe par sonar installé sous les bateaux apporte une meilleure résolution (quelques dizaines de mètres) mais une telle cartographie représente moins de 25 % des fonds et reste inefficace à la détection de structures particulières comme les cheminées hydrothermales.
Une première étape de la mission d’exploration de cette terra incognita est donc le déploiement d’un engin autonome – notre « AUV » IdefX – qui parcourt la zone d’étude pour fournir une cartographie sonar plus près du fond (à environ 70 mètres) avec 2 à 3 mètres de résolution. Il peut également être équipé d’autres capteurs pour mesurer par exemple la turbidité de l’eau ou le magnétisme du plancher océanique.
Cette cartographie permet ensuite de sélectionner les zones propices à du « terrain sous-marin » par l’intermédiaire d’un robot télécommandé, « Victor », qui sera en mesure de filmer et photographier le fond, prélever des échantillons de roches ou de fluides tout en mesurant leur température grâce à ses bras articulés contrôlés depuis la surface.
Cette campagne à la mer est avant tout née d’une collaboration que nous menons depuis des années, avec deux approches différentes et complémentaires des processus géologiques sous-marins. Muriel est minéralogiste, elle s’intéresse aux réactions chimiques entre fluides et roches à partir de l’étude d’échantillons naturels et d’expériences en laboratoire. Javier quant à lui, décrypte les processus tectoniques à partir de la morphologie fine des reliefs sous-marins. Nous avons soumis le projet scientifique en 2018. Il a été sélectionné la même année et nous voici, prêts au départ, en mai 2022.
Nous cherchons principalement à tester l’hypothèse d’une activité hydrothermale de basse température, que nous pensons diffuse sur l’ensemble du massif, et qui se développerait en parallèle de l’activité haute température très localisée au niveau des cheminées hydrothermales connues.
À bord du Pourquoi Pas ?
Le 5 mai, notre équipe de 24 scientifiques et 12 ingénieurs rejoint le navire Pourquoi Pas ? et ses 30 membres d’équipage de la flotte océanique française. À nous deux, co-chefs de mission, nous couvrons tous les besoins scientifiques à bord, ce qui permet une gestion plus efficace lors de la campagne, avec les aléas de la météo, les problèmes techniques, et le besoin d’atteindre les objectifs scientifiques. Des choix stratégiques doivent aussi être faits, et nos échanges facilitent la prise de décision.
Humainement, nous avons testé notre entente et nos complémentarités lors de précédentes missions. Elles sont indispensables pour mener l’ensemble des participants vers un projet collectif et constituer une équipe impliquée et motivée. Toute cette équipe scientifique, invitée à participer lors de la phase préparatoire, est bien sûr en appui à l’organisation et la définition des stratégies et objectifs scientifiques, en collaboration avec les équipes techniques des engins sous-marins et le personnel du navire, qui rendent tout cela possible.
Le transit vers la zone d’étude « Rainbow » dure deux jours. La météo est clémente, ce qui permet aux participants de « s’amariner » plus facilement. Chaque membre d’équipage a laissé à terre une situation personnelle et professionnelle un peu différente, entre les cours ou examens à déplacer et les vies de famille à organiser. Malgré ces complexités, l’aventure humaine et scientifique d’une campagne en mer est telle, puisqu’elle mène à la découverte de terrains à ce jour jamais explorés, qu’il y a de nombreux récidivistes parmi nous. Certains cumulent à ce jour plus d’une quinzaine de campagnes en mer, et côtoient des collègues qui découvrent les opérations à bord pour la première fois, avec plaisir et étonnement. Les plus expérimentés ont pu fournir, dès les étapes de préparation, de précieux conseils à ces novices, comme la nécessité d’amener assez de chocolats pour les soirées d’exploration du Victor ou des vêtements étanches pour l’utilisation de la scie à roche sur le pont.
À l’arrivée sur le site, l’équipe est désormais soudée et a organisé les labos et les opérations scientifiques à bord : préparation des instruments de mesure (recharge des batteries, calibration, paramétrage), planification des premières plongées à partir des cartes bathymétriques, organisation de la description des roches et de leur archivage, traitement des images des fonds océaniques déjà disponibles pour visualisations 2D et 3D géolocalisées.
Les plongées ont pu commencer immédiatement, durant la journée pour l’AUV, toute la nuit pour le robot télécommandé Victor. Avec elles, nous avons déjà fait de belles découvertes inattendues. Par exemple, nous avons détecté la présence d’un ancien site hydrothermal de haute température : il est maintenant éteint mais très similaire à celui qui est aujourd’hui actif. Nous avons aussi observé des plans de faille spectaculaires et leur association à des amas de bivalves fossiles. Mais le grand moment de découverte de ces premiers jours a été l’observation de bivalves vivants, autour de zones actives d’où s’échappent des fluides à basse température, ce qui était inconnu sur cette zone.
Hélas, au bout d’une semaine et pendant 2 jours, les aléas de la météo nous ont obligés à suspendre les opérations !
Mais nous ne manquons pas d’activité à bord : entre le traitement des données déjà acquises, la planification de la suite, les discussions scientifiques et stratégiques, nous sommes bien occupés en attendant la reprise des opérations – que vous pourrez suivre dans le prochain épisode de notre Chronique en mer.
Photo ci-dessus : Cheminée hydrothermale sur la zone d’étude. Image prise par « Victor », le robot télécommandé qui plonge à 2 000 mètres de fond et ramène des échantillons. Ifremer, Fourni par l’auteur
En partenariat avec Theconversation.fr.