Depuis 2010, la République populaire de Chine (RPC) est le premier consommateur mondial d’énergie primaire, devant les États-Unis. L’ambitieux plan de relance de l’économie chinoise (novembre 2008), comme le développement d’un vaste marché de consommateurs (en 2012, près de 20 millions de véhicules neufs ont été vendus dans le pays), ont permis à la Chine de maintenir un fort taux de croissance (8,2 % en 2012). Le charbon, dont la consommation a plus que doublé entre 2000 et 2012, demeure l’énergie primaire principalement brûlée dans le pays.
La Chine doit répondre à la forte demande d’électricité (dont le pays est devenu, en 2011, le premier producteur mondial), qui s’explique par la croissance du pays et l’urbanisation (à l’heure actuelle, seule la moitié de la population est citadine). Le développement du parc de centrales nucléaires est devenu une priorité, puisque le retard du pays est flagrant. Seuls dix-sept réacteurs nucléaires fonctionnent actuellement, contribuant à 2 % de la production d’électricité, contre 80 % pour le charbon et 16 % pour l’hydroélectricité. Vingt-huit nouveaux réacteurs sont en cours de construction, et la catastrophe de Fukushima n’a guère ralenti les projets nucléaires de la Chine, où les débats publics consacrés à l’atome restent très limités. L’Inde, qui est désormais le quatrième consommateur mondial d’énergie primaire, partage le même intérêt pour le nucléaire civil. Le modèle de développement de l’Inde suivi depuis une quinzaine d’années, fondé sur des activités à faible intensité de main‑d’œuvre, mais à forte intensité de capital intellectuel (comme l’informatique ou les biotechnologies), n’est pas suffisamment créateur d’emplois. L’Inde développe à son tour une puissante industrie, fortement consommatrice d’énergie, comme la sidérurgie et l’automobile. La situation de l’Inde est déjà particulièrement préoccupante, puisque le pays importe 75 % de sa consommation en pétrole. Le programme nucléaire civil de l’Inde a été contrarié par son refus d’adhérer au Traité de non-prolifération (TNP). Mais depuis septembre 2008, New Delhi a obtenu de la part des membres du Groupe des fournisseurs nucléaires (GFN), le droit d’acheter de la technologie nucléaire civile sous la surveillance de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), tout en conservant son arsenal nucléaire militaire. Une mesure qui permettra de construire de nouvelles centrales atomiques (actuellement vingt réacteurs, mais de faibles puissances, fournissent moins de 4 % de la production d’électricité du pays).
Contrairement aux pays émergents comme l’Inde ou le Brésil, les États-Unis ont une parfaite maîtrise de ces technologies nucléaires complexes, mais depuis l’accident survenu dans la centrale de Three Mile Island en Pennsylvanie (mars 1979), aucun nouveau réacteur n’a été construit dans le pays. L’adoption par le Congrès de l’Energy Policy Act en août 2005 constitue une première inflexion de la politique américaine, puisque la priorité est accordée à la promotion des énergies renouvelables et au développement de nouvelles centrales atomiques. En février 2012, les autorités américaines ont accordé leur autorisation pour la construction de deux nouveaux réacteurs dans la centrale de Vogtle, dans l’État de Géorgie (cf. photo ci-contre). Mais ce projet semble compromis depuis la catastrophe de Fukushima, et la remise en question du programme atomique au Japon et en Allemagne.
Depuis juillet 2011, les États-Unis sont redevenus exportateurs de produits pétroliers, une situation inédite depuis 1949 et qui annonce de profonds changements. La mise en valeur du pétrole issu des roches de schiste connaît une rapide progression, particulièrement au Texas, dans l’Oklahoma et dans le Dakota du Nord, grâce à l’amélioration des techniques d’extraction. Cette nouvelle production explique la diminution d’un tiers des importations nettes de pétrole (c’est-à-dire le volume des importations moins celui des exportations) entre janvier 2008 et janvier 2013. Si cette évolution se confirme, l’Amérique pourrait être en mesure de réduire drastiquement sa dépendance à l’égard de l’étranger au cours de la prochaine décennie, et de ce fait assurer son indépendance énergétique. Les données publiées par l’Agence pour l’information sur l’énergie (EIA) (2) sont plutôt encourageantes : la production américaine pourrait dépasser celles de l’Arabie saoudite et de la Russie dès la fin de cette décennie. Les États-Unis devraient néanmoins continuer de porter à la région du Moyen-Orient un intérêt soutenu, puisqu’elle assure un cinquième des importations en pétrole de l’Union européenne. Par leur présence militaire dans le golfe Arabo-Persique, les États-Unis garantissent la liberté de circulation maritime et de facto contrôlent l’approvisionnement pétrolier des pays asiatiques, et plus particulièrement de la Chine.
Mais cette sécurité énergétique risque d’être obtenue au mépris de l’environnement. La nécessité de créer des emplois et donc d’offrir une énergie abondante et bon marché amène à ignorer les conséquences néfastes d’une exploitation intensive des hydrocarbures par le biais de la fracturation hydraulique. En Europe également, l’Allemagne et la Pologne envisagent, mais dans un cadre réglementaire plus strict, d’exploiter leurs ressources de gaz non conventionnel. La Chine s’est engagée dans la mise en valeur de ses réserves de gaz de schiste (estimées autour de 25 000 mètres cubes, soit un niveau comparable à celles des États-Unis). L’absence de débats publics sur le sujet facilite cette démarche, même si de nombreux doutes subsistent sur la capacité technique des entreprises chinoises à mener à bien de tels projets industriels.
La Chine, désormais le deuxième consommateur et importateur mondial de pétrole, a vu sa consommation doubler depuis 2000. Aujourd’hui, la Chine doit importer 53 % de sa consommation en pétrole, une proportion qui passera probablement à près de 80 % en 2030. Au début des années quatre-vingt-dix, les sociétés chinoises privilégiaient les investissements dans les zones à risques ou dans des États soumis à des sanctions internationales, comme le Soudan et la Libye, afin d’obtenir des conditions contractuelles plus avantageuses. Puis les groupes chinois ont prospecté en Afrique, en Amérique latine et en Asie centrale, pour acquérir des droits d’exploitation de gisements d’hydrocarbures (3). Depuis quelques années, grâce au soutien financier des pouvoirs publics, plusieurs opérations de rachat ont été effectuées, comme sur les entreprises canadiennes PetroKazakhstan, Addax et Daylight Energy, ce qui permet d’accéder à leur technologie et à leurs réserves pétrolières. Ces acquisitions devraient se poursuivre dans les prochaines années. La hausse régulière de la production de charbon, comme de pétrole et de gaz (4), ces dix dernières années, ne fait que ralentir le déclin pourtant à terme inéluctable, de ces énergies primaires. Et la mise en valeur du pétrole et du gaz non conventionnels doit être prise avec prudence, tant les incertitudes sont grandes, notamment sur le rendement offert par les puits et les conséquences écologiques de cette exploitation.
Une lente, mais réelle transition énergétique
La forte production d’énergie fossile ne doit pas masquer une réalité : l’utilisation des énergies renouvelables progresse régulièrement. Depuis 2000, la capacité installée d’énergie éolienne dans le monde a été multipliée par près de 20, et la fabrication de biocarburants par six (mais elle demeure assurée à hauteur de 70 % par les États-Unis et le Brésil). En Chine comme en Inde, un effort est engagé pour accroître la part des énergies renouvelables. Une conscience écologique est en train de naître dans ces pays, longtemps uniquement préoccupés par leur croissance économique. L’opinion publique a évolué devant l’ampleur de la pollution et les conséquences parfois dramatiques de l’activité industrielle (nappes phréatiques souillées, rejets toxiques dans les fleuves) et de l’urbanisation.
La Chine dispose de plusieurs atouts dans ce domaine. En premier lieu, sa géographie, avec de vastes déserts comme ceux du Xinjiang ou de Gobi, qui offrent une longue durée d’ensoleillement, et des fleuves au débit puissant, qui s’étendent sur plusieurs milliers de kilomètres, comme le Yangtsé. Les coûts de revient dans l’industrie permettent aux entreprises comme Suntech ou JA Solar, de fabriquer plus de la moitié des panneaux solaires vendus dans le monde à des prix très compétitifs. Pour le moment, l’énergie hydraulique assure 90 % de la production d’énergie renouvelable. La RPC est le premier producteur mondial d’hydro-électricité – devant le Brésil – et d’énergie éolienne – devant les États-Unis. Après l’inauguration du barrage des Trois Gorges, d’autres infrastructures hydrauliques sont en cours de construction ou à l’étude. En Inde, la part des énergies renouvelables a fortement progressé. Le vaste littoral du pays (7 000 km) lui permet d’être le cinquième producteur mondial d’énergie éolienne. Mais en Asie, contrairement à la situation au Brésil et aux États-Unis, la part des biocarburants restera très faible dans les années à venir, du fait de la surface agricole très réduite. La Chine et l’Inde, qui comptent 37 % de la population mondiale, ne possèdent que 14 % des terres agricoles cultivables mondiales, d’après les données de la Food and Agriculture Organization (FAO, Nations Unies).
Une nouvelle géographie de l’énergie
Si la mise en valeur des gisements de gaz et de pétrole de schiste se confirmait en Amérique du Nord et en Chine, les prix du gaz devraient sensiblement baisser. Déjà aux États-Unis, sur le principal marché spot (5), le Henry Hub, le prix du gaz est en février 2013 de 3,43 dollars pour un million de BTU (6) contre 8,8 dollars en 2008, et un dilemme apparaît entre les partisans d’exporter cette production vers l’Europe, et ceux désireux de la conserver pour offrir aux industriels et aux particuliers une énergie bon marché. Un clivage entre Houston et Détroit. Pour l’instant, seul le projet du groupe Chenière de construire une usine de liquéfaction du gaz naturel en Louisiane, a été autorisé. Les exportations américaines de gaz naturel liquéfié (GNL) ne pourraient que contrarier la Russie, dont les prix du gaz restent particulièrement élevés, à cause des droits de transit à verser à la Biélorussie et à l’Ukraine, et de son indexation sur le cours du pétrole. Le prix du gaz russe s’établit autour de 10,6 dollars le million de BTU.
La Russie fournit aujourd’hui de l’ordre du tiers du gaz et du pétrole importé par l’Union européenne. En dépit de certaines vicissitudes, la Russie doit être reconnue comme un fournisseur loyal, puisque l’approvisionnement en hydrocarbures des Européens n’a jamais été menacé, y compris lors de la guerre froide. Rappelons également que l’Union européenne est le premier partenaire commercial de la Russie (et lui achète près de 60 % de ses exportations de gaz). La Russie redoute non seulement l’arrivée sur le marché européen du GNL en provenance des États-Unis, mais également le développement des gisements de gaz de schiste en Algérie et en Pologne, dont les réserves sont jugées prometteuses. La Chine, qui faisait figure de client potentiel pour Gazprom, préfère s’approvisionner en Asie centrale, particulièrement au Turkménistan, et met en valeur ses propres réserves de gaz de schiste. Vladimir Poutine a été lucide en affirmant en avril 2012, devant la Douma, que le gaz de schiste constituait un « grave défi » pour le pays. La baisse des cours des hydrocarbures risque de ruiner les efforts de reconstruction de la Russie, entrepris depuis l’arrivée au pouvoir de Poutine en 2000. Ces évolutions pourraient amener la Russie à envisager une coopération énergétique plus étroite avec le Japon. Après l’accident de Fukushima, le Japon a décidé de fermer 48 de ses 50 réacteurs nucléaires (7), le temps d’effectuer des mises aux normes de sécurité plus rigoureuses. L’avenir du programme nucléaire de l’archipel est encore flou, puisqu’à la fin de l’année dernière, le Premier ministre Shinzo Abe (issu du PLD, une formation de centre droit) a promis de relancer la construction de nouveaux réacteurs, mais présentant une meilleure sécurité. Une affirmation qui tranche avec les déclarations de son prédécesseur, qui en septembre 2012 avait annoncé que le pays allait fermer progressivement ses centrales atomiques dans un délai de trente ans. En attendant une position définitive, il est nécessaire de recourir aux importations d’hydrocarbures. La Russie, en dépit de sa proximité géographique, n’est qu’un fournisseur marginal de gaz naturel au Japon (elle couvre 8,5 % de ses importations). Une situation qui s’explique par des contraintes techniques (le gaz exporté vers le Japon doit être liquéfié, ce qui nécessite la construction d’infrastructures coûteuses) et des raisons politiques. Le contentieux des îles Kouriles (8) envenime toujours les relations diplomatiques entre les deux États, qui n’ont pas signé de traité de paix depuis 1945. Moscou et Tokyo devraient trouver dans les prochaines années un modus vivendi, afin d’exploiter en commun les gisements gaziers de l’Extrême-Orient russe. L’adhésion de la Russie à l’OMC offrira également un environnement juridique plus fiable aux investisseurs étrangers. Le Japon poursuit également ses recherches concernant les réserves de gaz issus des hydrates de méthanes, situés dans ses fonds marins.
La crise énergétique est sans doute à venir
Le choc pétrolier larvé que subissent les économies occidentales n’est pas comparable aux trois crises précédentes (lors de la guerre du Kippour en 1973, au moment de la révolution en Iran en 1979, et lors de la première guerre du Golfe en 1990), ni dans son ampleur, ni dans ses raisons. Aujourd’hui, il s’agit non d’une crise de l’offre, mais de la demande. Pendant l’année 1974, au moment du premier choc pétrolier, la production mondiale de pétrole avait été réduite de 5 %. Or aujourd’hui, jamais la production n’a été aussi importante, entre 2000 et 2011, elle a augmenté de 11 %, afin de suivre le rythme de la consommation mondiale. Ensuite, si les cours du pétrole semblent atteindre des sommets (avec un baril de brent (9) à Londres à 111 dollars au début du mois de mars 2013), ils restent comparables à ceux constatés au moment du deuxième choc pétrolier. En janvier 1981, le baril de pétrole de brent s’établissait à 38,85 dollars, soit en monnaie courante, 99 dollars. En moyenne, en 2010, le prix du baril de brent s’est établi à 79 dollars puis à 111 dollars en 2011. Le poids du pétrole dans la consommation globale d’énergie s’est aussi réduit, permettant d’amortir plus facilement le choc. En France, la consommation de pétrole a baissé d’un tiers depuis 1973.
À première vue, la hausse des cours du baril s’explique par la forte demande asiatique, puisque depuis 2000, la consommation en République populaire de Chine (RPC) a augmenté de 100 % et de 60 % en Inde. Néanmoins, cette explication d’une crise due à la demande asiatique n’est que partielle. La consommation de pétrole en Chine demeure encore faible comparée à celle des pays occidentaux, et particulièrement aux États-Unis. Rapportée au nombre d’habitants, la consommation en pétrole d’un Chinois est huit fois plus faible que celle d’un Américain et près de quatre fois plus faible que celle d’un Français. Alors que la Chine et l’Inde comptent le tiers de la population mondiale, ces deux États ne brûlent que 15 % de la consommation mondiale de pétrole, contre 43 % pour les États-Unis, le Japon et l’Union européenne, qui pourtant ne comptent que 13 % de la population du globe.
Les tensions sur les cours s’expliquent par plusieurs facteurs fréquemment soulignés par les observateurs : les menaces sur la liberté de circulation à travers le détroit d’Ormuz, proférées par l’Iran, et les situations d’instabilité politique au Vénézuéla comme au Nigéria. De même, des événements conjoncturels peuvent alimenter cette hausse, comme les fréquents cyclones à la fin de l’été dans le golfe du Texas ou la rigueur de l’hiver en Amérique du Nord, synonyme de forte consommation de fuel. Mais un fait mérite d’être relevé : l’absence sur les marchés internationaux, pendant plus de vingt ans, de l’Irak, qui détient pourtant 10 % des réserves mondiales de pétrole (au troisième rang derrière l’Arabie saoudite et l’Iran). En 1990, au moment de la première guerre du Golfe, l’Irak était le troisième exportateur mondial de pétrole. Pendant vingt ans, la production irakienne a fait cruellement défaut, puisqu’en moyenne de 1991 à 2011, le volume annuel de production n’a représenté que 60 % de celui de 1989.
La stabilisation politique de l’Irak devrait permettre d’enrayer la hausse des cours du pétrole, mais cela ne sera qu’un simple répit. L’épuisement des ressources mondiales en hydrocarbures est inéluctable, même si nul ne peut prédire sa date exacte. La hausse des cours permet de rentabiliser de nouvelles recherches, notamment en eaux profondes comme au large de l’Angola ou du Brésil, et de développer de nouvelles techniques, comme le traitement des sables bitumineux (au Vénézuéla et au Canada). Mais l’échéance de la pénurie est simplement retardée. La reprise économique dans les pays de l’OCDE devrait provoquer une plus forte demande en produits pétroliers et se traduire par une hausse des cours du pétrole, et le seuil des 150 dollars pour un baril de brent, atteint en juillet 2008, être à terme franchi. Seule une implication des pouvoirs publics (par des mesures fiscales destinées à modifier les comportements et par le financement de la recherche) permettra d’accélérer la transition énergétique.
À brève échéance, de fortes tensions sociales dans les pays du Tiers monde sont à redouter, car avec un fuel toujours plus cher, la production de matières premières agricoles et leur transport deviennent plus onéreux (le cours du blé à Chicago est passé de 500 cents le boisseau le 1er décembre 2006, à 931 dollars en juillet 2012). Une inflation également alimentée par l’évolution des modes de consommation dans les nations émergentes comme l’Inde et la Chine. Les révoltes sociales que plusieurs pays ont connues ces dernières années s’expliquent en grande partie par cette hausse du coût de la vie. Cette inflation du prix des produits alimentaires a été l’un des ferments des révolutions dans le monde arabe à partir de 2011.
Illustration : © DR
Notes
(1) La production d’énergie éolienne a un caractère intermittent, puisque le vent est une ressource aléatoire.
(2) World Energy Outlook, 2012.
(3) Cf. François Lafargue, La Guerre mondiale du pétrole, Ellipses, 2008.
(4) Depuis 2000, la production mondiale de pétrole a augmenté de 11 %, celle de gaz de 35 % et celle de charbon de 63 %.
(5) Le marché mondial du gaz est principalement régi par des contrats de fourniture à long terme (20 à 30 ans), dont les prix sont définis de manière contractuelle, et les marchés spot où se négocient des quantités limitées de gaz pour une livraison à court ou moyen terme.
(6) L’unité thermale britannique (BTU) mesure la quantité d’énergie dégagée par la combustion d’un volume de gaz naturel. Un million de BTU correspond à un volume d’environ 28 mètres cubes.
(7) Les quatre réacteurs de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi sont quant à eux définitivement arrêtés.
(8) Les îles Kouriles sont l’objet de disputes entre la Russie et le Japon depuis le début du XIXe siècle. Par le traité de San Francisco de 1951, le Japon a renoncé à ses droits sur les îles Kouriles, mais la délimitation exacte de cet archipel n’a pas été explicitée et le texte n’a pas été signé, ni par l’URSS, ni ensuite par la Russie. Le Japon continue de revendiquer quatre îles méridionales de l’archipel, qu’il désigne sous le terme de « Territoires du Nord », les considérant comme le prolongement de l’île d’Hokkaido et non concernées par les dispositions du traité de San Francisco.
(9) Le terme de « brent » désigne le pétrole plutôt léger, extrait des gisements de la mer du Nord.












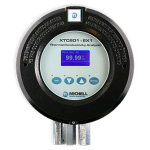
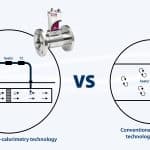
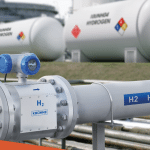













Ajouter un commentaire