Le rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) de septembre 2013 faisait état de la revue de 9 200 études scientifiques existantes d’après laquelle les experts du climat estimaient désormais « extrêmement probable » (à 95 %) que le dérèglement climatique soit dû aux activités humaines. Le CO2 n’est que l’un des gaz à l’origine de l’effet de serre (avec la vapeur d’eau, le méthane, les oxydes d’azote, l’ozone, et d’autres encore). Cependant, c’est celui qui a contribué le plus, à hauteur de 25 %, au réchauffement climatique, estimé à 1 °C depuis 1750. En effet, sa concentration dans l’atmosphère a augmenté de 40 % depuis l’âge préindustriel. Les grandes émissions de gaz carbonique d’origine humaine proviennent de la combustion des énergies fossiles, charbon, pétrole et gaz, dans la production d’électricité, les activités industrielles, les transports et le chauffage.
Selon le Global Carbon Project, qui compile chaque année les résultats de plusieurs instituts de recherche, en 2012, les émissions de CO2 ont encore augmenté. Le rapport, publié en novembre 2013, estime la hausse à 2,2 %. Le total des émissions atteint le chiffre record et préoccupant de 35 milliards de tonnes. Au premier rang des responsables, on trouve les combustibles fossiles. Ainsi, en 2012, le charbon a connu une croissance de 2,8 %, le gaz une hausse de 2,5 % et le pétrole une augmentation de 1,2 %.
Dans le cadre du protocole de Kyoto, l’ensemble des pays s’est engagé à réduire les émissions de façon à stabiliser le climat. L’objectif est de ne pas dépasser une hausse de 2 °C, au-delà duquel des phénomènes de nature catastrophique pourraient se manifester. Pour cela, la concentration atmosphérique de CO2 ne doit pas dépasser 450 ppm (partie par million), ce qui nécessite de réduire de plus de 50 % les émissions de CO2 d’ici 2050, par rapport à 1990, année de référence. Les nouveaux chiffres présentés par le Global Carbon Project représentent au contraire une hausse cumulée de plus de 60 % par rapport à l’année 1990.
Le rapport du GIEC de septembre 2013 présente différents scénarios, montrant des conséquences potentielles du réchauffement climatique très inquiétantes : fonte des glaces polaires (la calotte du Groenland pouvant disparaître complètement d’ici 2100), entraînant une élévation du niveau moyen des mers jusqu’à près d’un mètre, inondation de nombreuses zones côtières menaçant des centaines de millions d’habitants contraints à l’exil ; aggravation de phénomènes météorologiques extrêmes tels que les tempêtes (on cite souvent l’exemple récent de l’ouragan Sandy), les cyclones, les crues fluviales. C’est un bouleversement complet des écosystèmes et des équilibres naturels de la planète que nous laissent envisager les modèles des climatologues.
Les atouts de l’énergie nucléaire
La production d’énergie représente à elle seule 60 % de la production de CO2. La production d’électricité représente 25 %. Elle offre un potentiel important de réduction, dans la mesure où des techniques de production, nucléaires et renouvelables existent aujourd’hui. Aussi, elle est amenée à croître. On anticipe en effet d’ici 2030 un doublement de la demande d’électricité, liée à la fois à la croissance démographique (plus de 9 milliards d’habitants en 2050 d’après les Nations unies) et à la hausse du niveau de vie dans les pays émergents.
Si l’on prend en compte des émissions de CO2 sur l’ensemble de son cycle de vie, le nucléaire émet aujourd’hui environ 15 grammes de CO2 par kilowatt heure (gCO2/kWh), contre 500 gCO2/kWh pour le gaz et 1000 gCO2/kWh pour le charbon. Le nucléaire se situe au même niveau que les renouvelables, entre l’éolien et le photovoltaïque. Il permet d’éviter des rejets significatifs par rapport en particulier à une centrale à charbon : pour une puissance de 1000 MW, une centrale nucléaire évite annuellement le rejet dans l’atmosphère d’environ 6,5 millions de tonnes de CO2. Cela est d’autant plus précieux qu’un think tank américain spécialisé dans les questions environnementales, le World Resources Institute, a recensé dans son rapport publié en novembre 2012 près de 1200 projets de nouvelles centrales à charbon dans le monde, principalement en Chine et en Inde.
Le nucléaire représentait en 2011, d’après l’AIE (Agence internationale de l’énergie), 11 % de l’électricité produite dans le monde, en comparaison avec les énergies fossiles à 68 % et les énergies renouvelables à 20 % (dont 16 % d’hydraulique). Cette part, a priori modeste et amenée à rester stable dans le futur, se révèle fort significative en termes d’émissions évitées. Même si elle n’est pas disponible dans tous les pays, l’énergie nucléaire est maîtrisée par la plupart des pays de l’OCDE, lesquels sont à la fois les plus gros consommateurs d’électricité et les plus importants émetteurs de CO2. Ce sont aussi ceux qui portent l’essentiel de la charge de réduction des émissions de CO2 d’ici 2050, dans les objectifs de Kyoto. Sur la base des données de l’AIE, un rapide calcul montre que la production électronucléaire a déjà permis d’éviter l’émission de 1,6 milliard de tonnes de CO2 en 2013. Cette simulation est faite en prenant l’hypothèse que, si l’énergie nucléaire n’existait pas, sa production, soit 2756 TWh en 2013, serait remplacée par une hausse correspondante de la production des autres sources (charbon, gaz, renouvelables) dans leurs proportions relatives actuelles (exception faite de l’hydroélectricité dont le potentiel de croissance est limité dans les pays développés qui disposent aujourd’hui de l’énergie nucléaire).
Comment cette contribution à la modération des émissions de CO2 va-t-elle évoluer ? D’abord, le nucléaire sera toujours là en 2030. D’après l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), 438 réacteurs nucléaires opéraient dans le monde début 2014 pour une capacité de 374 GW, et 71 réacteurs étaient en construction. L’AIEA prévoit une forte hausse de l’utilisation de l’énergie nucléaire dans le monde, entre 23 et 100 % d’ici à 2030.
Quand les instances internationales omettent de mentionner l’énergie nucléaire
Le 22 janvier 2014, la Commission européenne a présenté à la presse les propositions du second « paquet énergie-climat » dans lequel se dessinent les contours d’une nouvelle politique énergétique européenne. Au programme : un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 %, en ligne avec les objectifs de Kyoto ainsi qu’un objectif de porter à 27 % la part des énergies renouvelables dans la consommation énergétique totale de l’Union européenne (UE). Cependant, la Commission ne parle pas d’énergie nucléaire. Cette omission paraît bien paradoxale. En effet, l’énergie nucléaire représente aujourd’hui presque 30 % de l’électricité produite dans l’UE et assure au quotidien pas moins des deux tiers de son électricité décarbonée.
La Commission européenne n’est pas la seule instance internationale à ne pas accorder à l’énergie nucléaire la place qu’elle devrait tenir parmi les autres moyens de lutte contre le réchauffement climatique. En 1997, l’adoption d’un protocole à la Convention sur le climat dit « protocole de Kyoto » avait déjà exclu l’énergie nucléaire d’un certain nombre de mécanismes comme le mécanisme de développement propre (MDP) qui vise à récompenser financièrement toute instauration de technologies permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les pays en voie de développement.
Près de 120 experts du GIEC ont de leur côté consacré un rapport entier en 2011 à des scénarios de développement des énergies renouvelables, indiquant un potentiel technique pour passer d’une part de 13 % d’énergies renouvelables en 2010 à 80 % en 2050. Ces scénarios permettraient d’atteindre l’objectif de 2 % seulement de hausse de la température moyenne. Il est étonnant que le nucléaire, l’une des énergies non carbonées disponibles sur la même période dans un nombre important de pays de l’OCDE − qui sont justement des pays fortement émetteurs de CO2 − ne soit pas étudié.
De son côté, la Banque mondiale qui prépare des plans pour fournir de l’électricité à 42 pays exclut l’énergie nucléaire préférant favoriser l’hydraulique, la géothermie, le solaire et l’éolien. Selon son président, Jim Yong Kim, l’énergie nucléaire est une question « très politique » dont la Banque mondiale ne s’occupe pas. En revanche, elle finance des projets de centrales à charbon, l’énergie la plus fortement émettrice de CO2. Cela a été le cas dernièrement en Afrique du Sud, pays qui pourtant dispose aujourd’hui de l’énergie nucléaire.
Dans chaque cas, on constate l’influence de pays ou d’organisations non gouvernementales pour qui le nucléaire est une source d’inquiétude, par exemple en termes de sûreté ou de non-prolifération. Ces débats, légitimes, ne sont pourtant pas du ressort des politiques climatiques. Ils sont du ressort et du pouvoir de contrôle d’une autre agence de l’ONU, l’AIEA à Vienne. Bannir le nucléaire de la liste des options a pour effet de limiter les choix de solutions techniques et de mesures gouvernementales pour atténuer les dangers du dérèglement climatique. Cela fait courir des risques de délais ou d’échec dans l’atteinte des objectifs de réduction des émissions des gaz à effet de serre. Il est clair pourtant aujourd’hui que, pour stabiliser la teneur en CO2 de l’atmosphère, il faudra mettre en œuvre des politiques d’envergure, faisant appel à l’éventail le plus complet possible de technologies et d’instruments économiques et réglementaires. Intégrer l’option nucléaire relève à ce stade du principe de précaution.
Ainsi, les scénarios qui prévoient 85 % de renouvelables en 2050, et qui argumentent que l’on n’aurait pas besoin de nucléaire, semblent des paris très incertains et des hypothèses fragiles en termes de technologies, de financements et de volonté politique. Un porte-parole du World Energy Congress (WEC) annonçait ainsi récemment que la consommation mondiale de charbon augmentera encore de 25 % d’ici 2020 au niveau de 4500 Mtep. Elle dépassera la consommation de pétrole à 4 400 Mtep et deviendra alors la première source d’énergie du monde. On estime ainsi que la moitié de la nouvelle capacité énergétique construite en Chine d’ici 2020 sera à base de charbon. Cette capacité sera encore opérationnelle en 2050.
énergies renouvelables et non-diminution des émissions de gaz à effet de serre
Le 29 janvier 2014, le Commissariat général à la stratégie et à la prospective (CGSP) dressait le même constat que le cabinet de conseil Capgemini avant lui : le marché européen de l’électricité, mis à mal par l’afflux non maîtrisé sur le réseau d’énergies intermittentes subventionnées, est en crise. Pour rompre avec cette situation, le CGSP plaide pour que la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) soit la première priorité du paquet énergie-climat 2030.
En termes de lutte contre le réchauffement climatique, la priorité est, elle aussi bien sûr, de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Aussi, il est inexact de penser, comme le laisse supposer la Commission européenne, que l’augmentation de la part des renouvelables dans le mix énergétique conduit nécessairement à une diminution des émissions de CO2. Cette relation est complexe et dépend du contexte lié à chaque pays. On peut ainsi citer en Europe trois exemples très différents.
Le premier exemple est l’Allemagne. Le pays a fortement investi ces dernières années dans l’éolien et le photovoltaïque, dans le cadre de son programme « Energiewende » (le « tournant énergétique »), lequel prévoit aussi la sortie du nucléaire en 2022. Les énergies renouvelables ont représenté 22 % de la production d’électricité en 2012, pour des subventions de 20 milliards d’euros par an. Pourtant, en 2012 le pays a connu une hausse de 1,8 % de ses émissions de CO2. En même temps que la part d’électricité nucléaire a diminué, la part du charbon s’est développée au-delà de 40 %, avec une augmentation de 4,2 % des émissions associées. En décembre, un accord gouvernemental a plafonné la part des renouvelables à 60 % du mix en 2035, reconnaissant par là même que la production d’électricité par les énergies fossiles demeurerait à au moins 40 %.
Dans le cas de la France, 90 % de l’électricité produite aujourd’hui est décarbonée, avec 75 % de nucléaire et 15 % de renouvelables, principalement hydroélectrique. Dans ce cas précis, il est clair que l’augmentation de la part des renouvelables dans le mix électrique n’aura guère d’impact en termes d’émissions de CO2. La part des énergies fossiles qui restent dans le mix est nécessaire à la gestion de la pointe. En revanche, la France dispose d’un fort potentiel de réduction des émissions dans le transport, et surtout dans le chauffage, où le fioul et le gaz peuvent être substitués par une augmentation du parc de pompes à chaleur, la biomasse et le biogaz.
Enfin, le troisième exemple est celui du Royaume-Uni. Historiquement marqué par ses mines de charbon, puis par son exploitation du pétrole et du gaz naturel offshore en mer du Nord, le pays est devenu, depuis quelques années, importateur net de gaz. Près de 70 % de son électricité est encore carbonée. Pour réduire ses émissions, le Royaume-Uni a choisi des investissements massifs à la fois dans l’éolien et dans le nucléaire. Ainsi, il est aujourd’hui le troisième producteur d’électricité éolienne en Europe et accueille la moitié de la base installée européenne d’éolien offshore. Dans le nucléaire, il vient d’annoncer un accord pour la construction de deux EPR, centrales nucléaires de toute dernière génération, à Hinkley Point. Il projette quatre unités additionnelles. Dans ce cas précis, le Royaume-Uni a optimisé entre les renouvelables et le nucléaire, en fonction de ses propres ressources et contraintes.
Une nouvelle génération d’écologistes réhabilitent le nucléaire comme outil de lutte contre le réchauffementclimatique
Dans son film documentaire Pandora’s Promise, sélectionné en 2013 au festival indépendant de Sundance et présenté au Traverse City Film Festival organisé par Michael Moore, le réalisateur américain Robert Stone retrace les trajectoires personnelles de plusieurs militants écologistes et d’experts de l’énergie dont les convictions, initialement antinucléaires, ont évolué. Financé de manière indépendante, le film aborde leur déception et leur manque d’espoir dans les processus internationaux de lutte contre le réchauffement climatique, et dans la capacité des énergies renouvelables à pallier la croissance et la domination mondiale du charbon. Il aborde aussi les mythes et les connaissances relatifs à la question du nucléaire, souvent très émotionnelle. Le film révèle la tendance qui se développe, au sein de différents groupes écologistes, de revenir sur des positions d’opposition drastiques au nucléaire. Ces nouvelles générations de militants reconnaissent, sous conditions de sûreté renforcée, une place au nucléaire dans la lutte contre le dérèglement du climat. Le documentaire, diffusé au grand public aux États-Unis sur CNN, n’a pas trouvé preneur parmi les chaînes de télévision européennes. Il est disponible aujourd’hui en téléchargement sur iTunes.
Quatre grands climatologues américains, professeurs d’université et experts internationalement reconnus dans ce domaine − Dr. Ken Caldeira (Carnegie Institution), Dr. Kerry Emanuel (Massachusetts Institute of Technology), Dr. James Hansen (Columbia University Earth Institute) et Dr. Tom Wigley, Climate Scientist (University of Adelaide) − ont encouragé ces initiatives, par une lettre ouverte publiée à l’automne 2013 dans le Washington Post. Dans cette lettre, ils interpellent les organisations écologistes traditionnelles : « L’opposition continue à l’énergie nucléaire menace la possibilité pour l’humanité d’éviter un changement climatique dangereux. » Ils les invitent à soutenir « la mise en œuvre et le développement de systèmes de centrales nucléaires plus sûres comme moyen pratique de résoudre le problème du changement climatique ». Enfin, ils concluent en disant qu’« il n’y a pas de chemin crédible à la stabilisation du climat qui n’inclut pas un rôle important pour l’énergie nucléaire ».
Ces mouvements, comme par exemple le think tank indépendant californien, The Break Through Project, fondé par d’anciens membres du Sierra Club, se développent dans les pays anglo-saxons. Ils participent à des débats contre les anciennes générations d’écologistes antinucléaires, comme par exemple Ralph Nader lors du débat qui a suivi la projection sur CNN du film Pandora’s Promise. Ils entendent faire passer leur message en préparation au Sommet du climat qui se déroulera à Paris en décembre 2015.
Illustration : vue d’artiste de la future centrale thermique au charbon d’Anhui Tongling, dans le centre de la Chine, d’une puissance cumulée devant atteindre 2 000 MW (© Emerson)














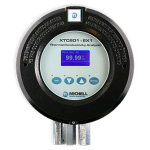
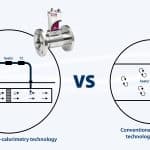
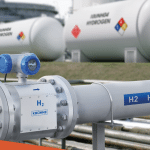











Ajouter un commentaire