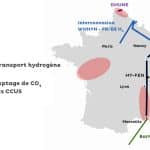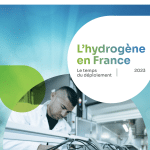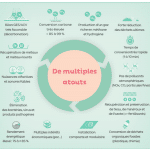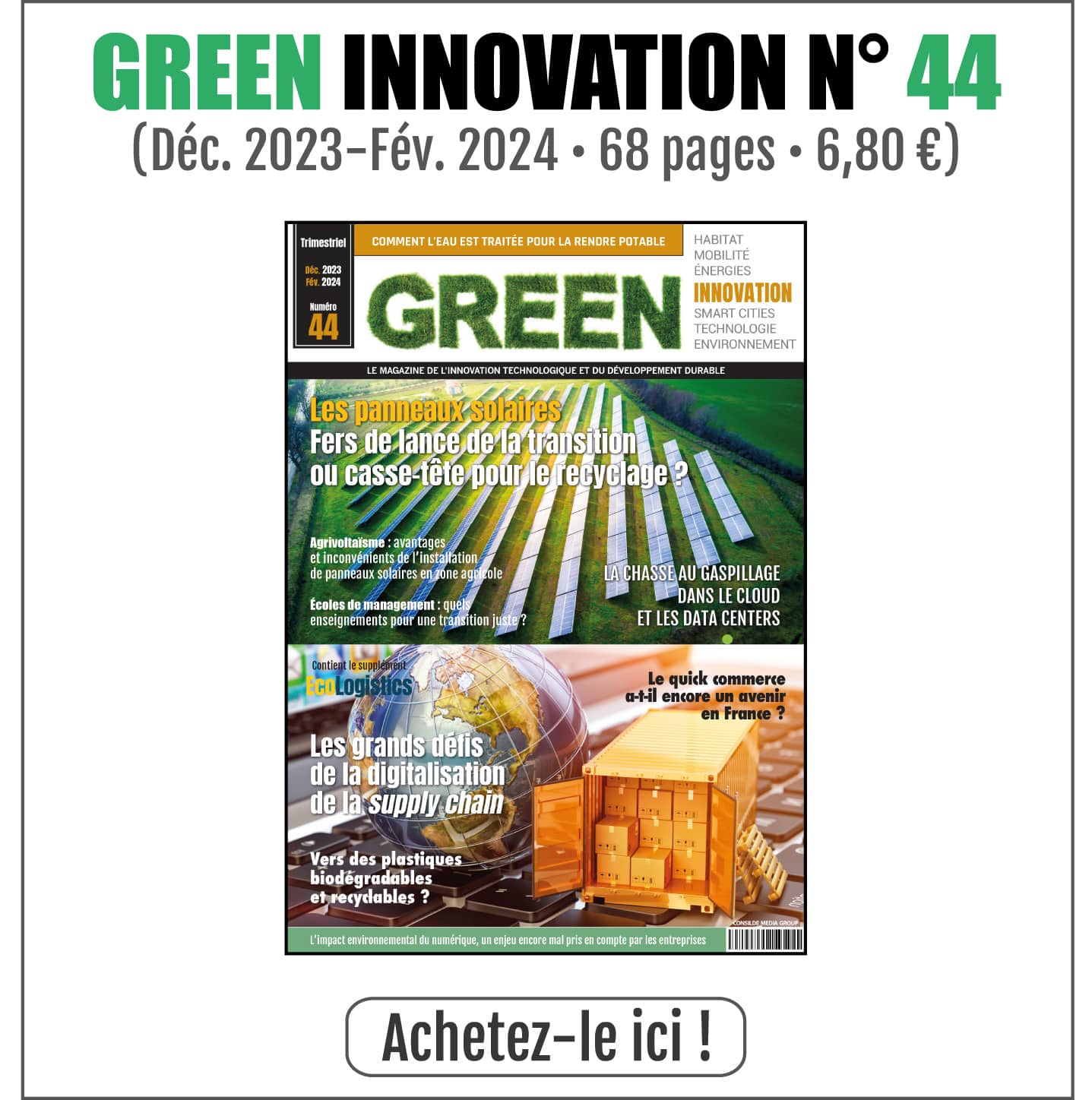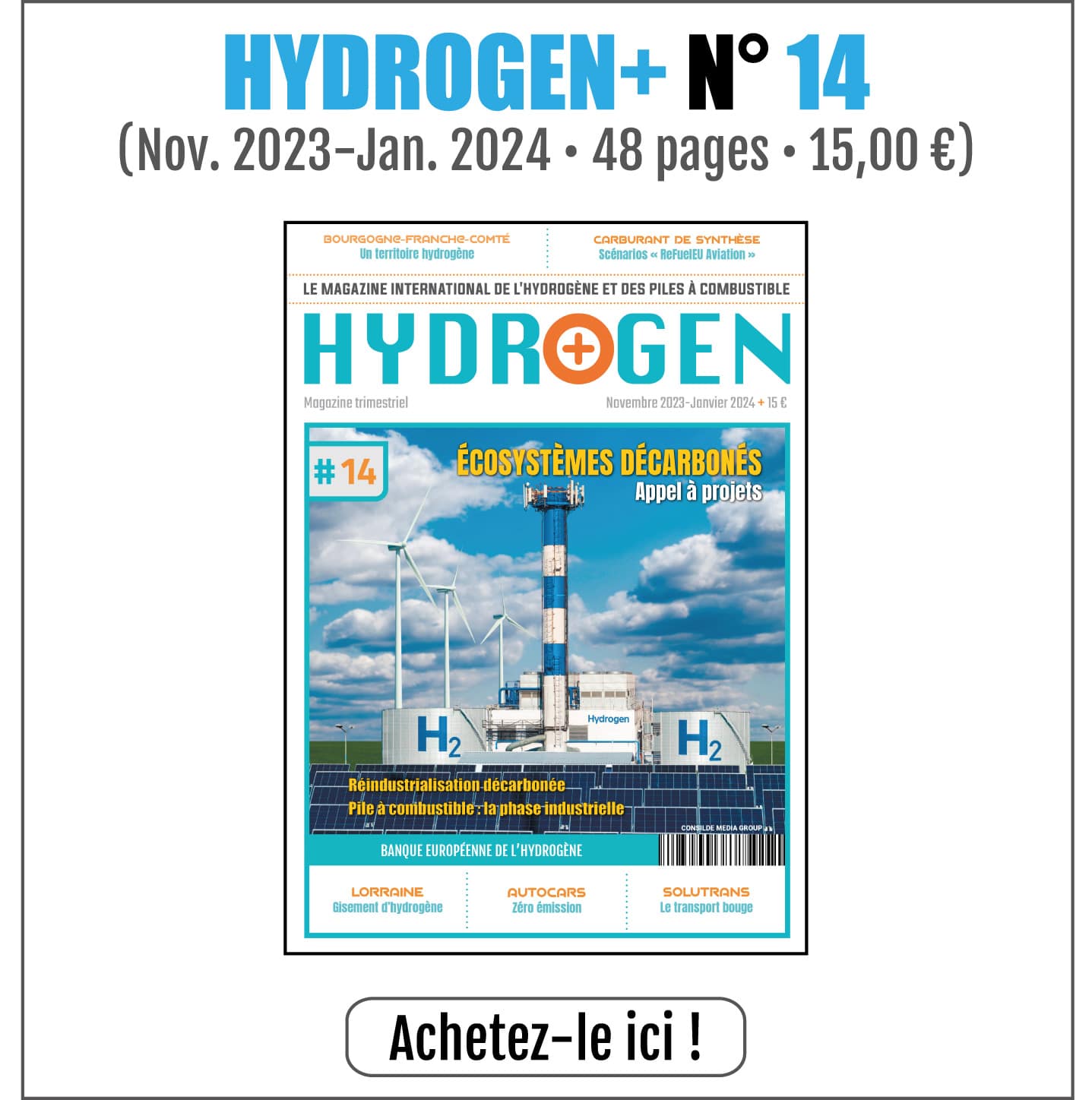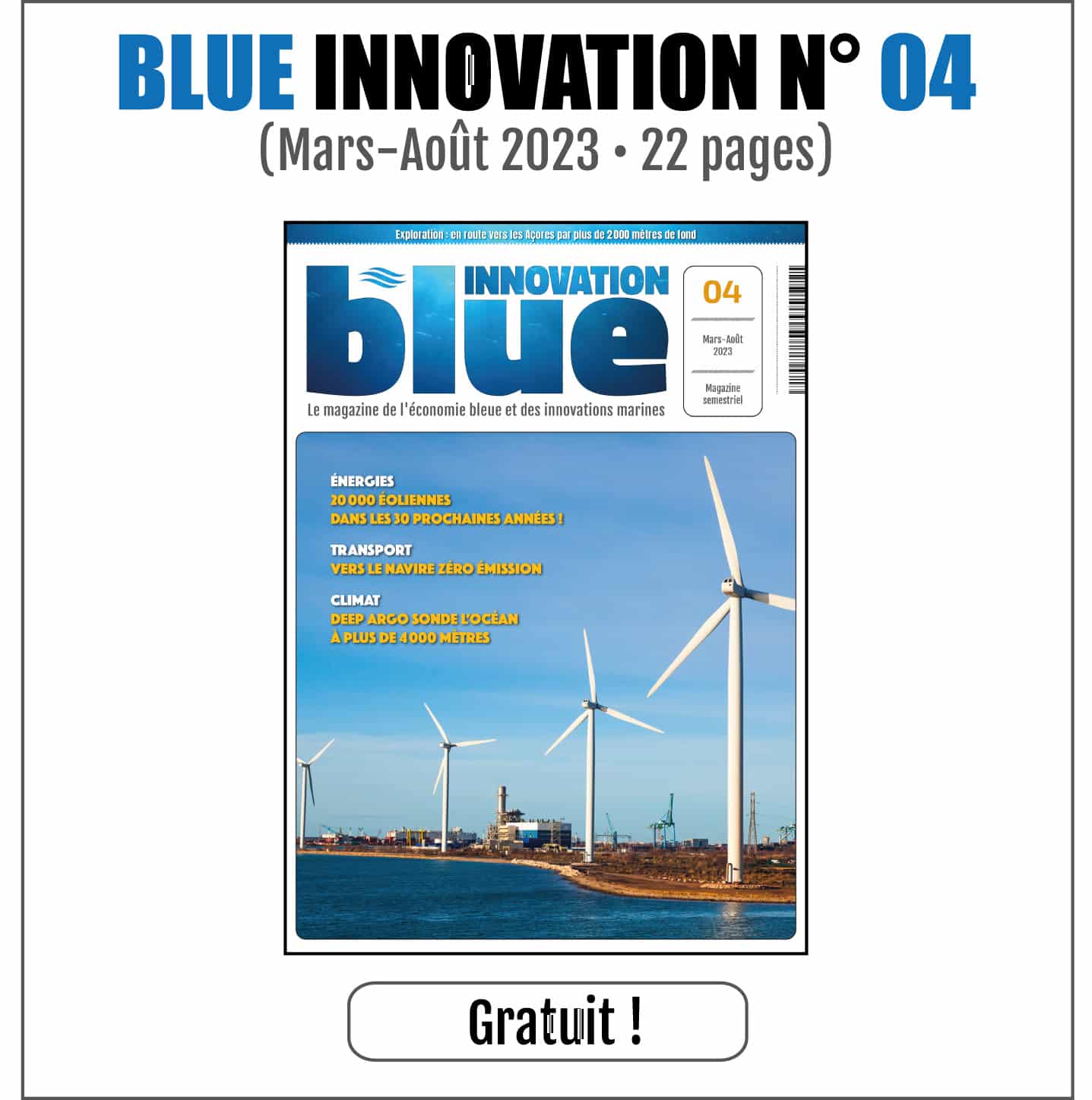Green Innovation. La transition énergétique n’est bien sûr pas qu’une affaire d’État. Les grands groupes des nouvelles technologies et du web (Google, Apple, Facebook…) se veulent à l’avant-garde dans ce domaine. Depuis quand sont-ils engagés dans cette mutation et avec quelles motivations ?
Cedric Christensen. L’intérêt des grands groupes américains pour les énergies renouvelables et la transition énergétique remonte à 2005, lorsque le Sénat des États-Unis adopte un vaste plan énergétique – l’Energy Policy Act – pour accélérer l’adoption des énergies nouvelles. Ce texte crée un crédit d’impôt appelé Investment Tax Credit (ITC), qui s’applique à toutes les nouvelles installations solaires, éoliennes, et autres technologies nouvelles de l’énergie. Dès 2006 et 2007, les « Fortune 500 » [500 premières entreprises américaines d’après le magazine Fortune, NdlR] commencent l’installation de parcs éoliens et solaires sur leurs bâtiments pour réduire leurs factures énergétiques et profiter de ce crédit d’impôt de 30 % sur les investissements.
Le cas de Google illustre bien le cheminement des géants de la Tech. En 2007, Google construit la plus grande installation de solaire commercial du pays, avec 1,6 MW d’énergie photovoltaïque sur ses bureaux de Mountain View. Puis, en 2010, il investit 39 millions de dollars de tax equity (réductions d’impôts) dans sa première ferme d’éoliennes. Le projet porte sur 170 MW de capacité, appelé « Peace Garden Wind », dans le Dakota du Nord. Deux ans plus tard, le montant des investissements de Google dans des projets d’énergie renouvelable atteint un milliard de dollars. En 2017, l’investissement a quasi triplé. La course aux renouvelables est lancée et elle est mondiale.
L’impact sur le climat de la consommation grandissante d’électricité par le secteur numérique, notamment pour alimenter ses énormes data centers, a été dénoncé par plusieurs ONG dès les années 2000. Où en sont ces géants « technologiques » de leur propre transition énergétique ? Quels sont les leaders et les retardataires en la matière ?
Plusieurs ONG américaines ont analysé la consommation énergétique des centres de traitement de données. Natural Ressources Defense Council (NRDC) estimait, dans son Data Center Efficiency Assessment d’aout 2014, qu’en 2013, 91 milliards de kilowatts-heures d’électricité avaient été consommés dans les data centers aux États-Unis – soit l’équivalent de la production énergétique annuelle de 34 centrales de 500 MW. D’après l’ONG, cette consommation pourrait grimper jusqu’à 140 milliards de kilowatts-heures en 2020 et couterait 13 milliards par an aux sociétés américaines.
En matière de création et d’entretien de centres de stockage de données, les géants du numérique sont à la pointe de la technologie. Ils démontrent des gains d’efficacité considérables. Par contre, les PME sont à la traine en matière de gestion énergétique des données. Une des causes de ce retard, évoquée dans le rapport de NRDC, tient au fait que les PME partagent l’espace des centres de stockage de données avec d’autres sociétés. Par conséquent, elles n’ont pas une complète maitrise des choix d’investissement dans l’efficacité énergétique. Selon ce même rapport, le fait que les centres de stockage de données soient conçus pour faire face à des pics d’activité qui n’arrivent que quelques fois par an est une autre source d’inefficacité, car le reste du temps, ils sont sous-exploités. La virtualisation des processus informatiques, qui consiste à grouper les requêtes pour une meilleure utilisation du matériel, est donc perçue comme une manière efficace de réduire le nombre de serveurs et d’augmenter leur efficacité.
Pour faire face à la croissance de la demande énergétique liée aux centres de données, les GAFA ont acheté plus de 4 GW d’énergies renouvelables entre 2012 et 2017 aux États-Unis et au Mexique, selon le Rocky Mountain Institute, un centre de recherche américain spécialisé. Cette capacité énergétique pourrait alimenter plus d’un million de foyers français.
Pour y arriver, Google, Apple, Facebook et Amazon signent plusieurs types de contrats. Il peut s’agir de contrats d’achat d’électricité directement avec de nouveaux projets éoliens ou solaires. Dans ce cas, ils s’engagent sur une période donnée à acheter la production d’énergie du projet. Une autre manière de subvenir à leurs besoins en énergies renouvelables consiste à négocier des « blocs d’énergie verte » avec les fournisseurs d’énergie traditionnelle ou des traders, qui, eux, se tournent vers les marchés pour trouver les ressources. Enfin, d’autres achètent des titres ou des crédits d’énergie renouvelable (Renewable Energy Credit) à d’autres producteurs. C’est ce dernier cas qui est le plus contesté, car il n’augmente pas en soi la capacité renouvelable et peut juste déplacer les émissions d’une région à une autre.
Alors que Google et Apple affichent 100 % d’énergie renouvelable, Amazon et Facebook restent à la traine en la matière. Fin 2016, Amazon atteignait 40 % de renouvelables dans l’énergie consommée par son infrastructure globale. L’objectif de 50 % devrait être atteint fin 2017. Facebook est dans la même zone, avec un objectif de 50 % en 2018. À noter cependant qu’avec des objectifs affichés de 100 % renouvelables, ces sociétés vont chercher à construire de nouveaux centres de traitement de données dans des régions où l’accès aux énergies renouvelables abonde déjà (au détriment de celles où il est à développer).
Forts de leur puissance financière et de leurs capacités d’innovation, ces mêmes groupes sont en train de s’imposer également comme fournisseurs sur le marché des énergies renouvelables (EnR).
Quelles sont leurs stratégies, restent-elles concentrées sur certaines zones géographiques, et comment leur arrivée redessine-t-elle ce marché ?
Il y a plusieurs cas notables de « géants consommateurs » utilisant leur puissance financière pour se désolidariser du réseau électrique et même, parfois, devenir leurs propres fournisseurs. C’est une forme de déclaration d’indépendance et aux États-Unis, on appelle ces cas des « RExits » (pour « Renewable Energy Exits »).
Les motivations des grandes corporations pour s’affranchir du réseau sont multiples. Premièrement, il peut s’agir d’une manière de contrôler leurs couts énergétiques en gagnant un accès direct aux marchés de l’énergie. D’autres ne trouvent pas le mix énergétique nécessaire à la réalisation de leurs objectifs de réduction de CO2 et se voient dans l’obligation d’acheter de l’énergie propre directement auprès de nouvelles installations solaires et éoliennes. Ce type de contrat s’appelle un Power Purchase Agreement (PPA) et permet à la société d’acheter la totalité ou une partie de la production sur la durée de vie du projet. Enfin, il convient de noter que des groupes comme Google, Apple, Facebook, Amazon ont des butins colossaux qu’ils ont amassés dans leur activité principale et l’appétit pour les réductions d’impôts fait de l’énergie renouvelable une cible prioritaire avec des retours sur investissement qui peuvent atteindre 10 à 15 %.
Tout comme le Brexit, les RExits ont un cout important pour le sortant. MGM, le fameux casino de Las Vegas, a négocié en mai 2016 sa sortie du réseau électrique de Nevada Power. En effet, l’objectif du Casino était de se fournir à 47 % en énergies renouvelables sachant que le Nevada’s Renewable Energy Standard impose un objectif de 23 % aux fournisseurs d’énergie. MGM a négocié son RExit à 87 millions de dollars. C’est le montant, estimé par les régulateurs, des investissements moyens et longs termes qui ont été effectués pour planifier le développement du réseau et servir les 171 MW de capacité énergétique qu’utilise le Casino. Microsoft a suivi la même voie avec le fournisseur d’énergie Puget Sound Energy dans l’État du Washington en avril 2017. Le RExit fee s’élève à 28 millions de dollars.
Dans d’autres États, comme en Californie, il existe des moyens légaux de se substituer au fournisseur d’énergie et d’acheter directement l’énergie sur les marchés. Google et Apple ont tous les deux suivi cette voie en devenant des consommateurs en accès direct (Direct Access customers). Les deux ont également sollicité l’accord de la Federal Energy Regulatory Commission pour opérer une licence d’exploitation du réseau. Cette étape leur permet de se soustraire au contrôle de certaines entités étatiques qui régulent les fournisseurs d’énergie et ainsi de gagner une grande indépendance dans leurs choix d’investissements.
Certains consommateurs en accès direct, comme l’University of California San Diego (UCSD), sont connus pour être des leaders mondiaux de l’innovation énergétique, car leurs investissements échappent au test du meilleur rapport qualité/prix (least cost/best fit) qui est devenu la philosophie d’une majorité de régulateurs et qui a pour objectif de défendre tous les usagers contre les hausses de tarifs. L’UCSD opère un microgrid, c’est-à-dire un petit réseau d’usagers avec une source d’énergie qui peut être rattachée au réseau central, mais qui peut aussi fonctionner de façon indépendante. Le microgrid UCSD dispose de 35,1 MW d’énergie générés sur le site, ce qui couvre 75 % de la demande annuelle du campus.
Certains grands groupes de l’énergie ont pris eux aussi le chemin de cette transition, notamment en Europe. Quelle est la réaction des acteurs historiques du secteur à l’arrivée des « technologiques » ?
Il existe plusieurs types de sociétés qui tentent de bousculer les acteurs historiques et d’entrer sur ces marchés. Ces nouveaux entrants agissent forcément sur l’un (ou plusieurs) des trois piliers nécessaires pour maintenir un système électrique fiable : la production d’énergie, le réseau qui permet aux électrons de circuler jusqu’au client final, et la relation avec les usagers (facturation, services).
Des groupes comme ENGIE, Direct Energy et, plus récemment, Total, payent un droit d’utilisation du réseau existant et jouent sur leur savoir-faire en tant que fournisseurs de ressources et/ou gestionnaires de clients pour tenter d’offrir un meilleur service que les intervenants traditionnels. Le service proposé peut attirer de nouveaux clients parce qu’il inclut plus d’énergies renouvelables, parce qu’il est moins cher, ou plus fiable.
De façon plus révolutionnaire, d’autres groupes comme Tesla et Sonnen offrent des services qui combinent production distribuée et gestion du client final. Dans le monde tel que l’envisage Elon Musk, le toit de la maison pourrait alimenter les besoins en énergie du foyer et de la voiture. Dans ce cas, le réseau électrique pourrait être utilisé simplement comme une plateforme pour vendre un excès de production ou combler un manque, une sorte d’eBay de l’énergie !
L’arrivée massive des ressources énergétiques distribuées telles que le solaire résidentiel, le stockage d’énergie, et les véhicules électriques est en train d’opérer un transfert du pouvoir d’un système centralisé, puisant son énergie dans quelques centrales fournissant d’énormes quantités d’énergie, vers un système où les consommateurs se réapproprient petit à petit les outils de production ou de gestion énergétique. Plusieurs sociétés américaines et européennes utilisent les technologies de l’Internet pour créer des « centrales virtuelles », c’est-à-dire des systèmes complexes de ressources énergétiques distribuées qui peuvent être combinées pour ressembler à des centrales thermiques.
Par exemple, eMotorwerks, une société spécialisée dans les stations de chargement de véhicules électriques, a réussi à démontrer aux fournisseurs d’énergie californiens que ses usagers pouvaient répondre à des signaux du réseau en temps réel et modifier leurs temps de charge de quelques heures pour soulager le système en période de nécessité. La société a gagné un contrat de 50 MW, sous forme de « negawatts », c’est-à-dire que durant les périodes où la demande d’énergie excède l’offre, eMotorwerks peut être appelé par l’opérateur du réseau pour « freiner » la charge. Une fois habitués au concept, ces mêmes clients peuvent aussi devenir des ressources en période de surproduction solaire ou éolienne. L’opérateur de réseau pourrait alors émettre un signal poussant des milliers d’usagers vers des bornes de chargement pour absorber le surplus en échange d’un taux avantageux, par exemple.
Toutes ces innovations sont rendues possibles grâce aux smart grids et aux compteurs intelligents (comme le Linky en France) qui permettent de comptabiliser les kilowatts-heures consommés au réseau et ceux injectés, de façon quasi instantanée. Grâce à ces informations en temps réel, les ressources énergétiques distribuées peuvent devenir des atouts pour les gestionnaires de réseau en permettant d’absorber les surplus et de les redistribuer en fonction des besoins du réseau. C’est le grid 2.0.
Cependant, dans beaucoup de pays, les acteurs historiques voient l’arrivée de ces nouveaux produits énergétiques comme un risque, surtout dans des situations de monopoles naturels où la production, l’acheminement, et la gestion de clients sont gérés par la même entité. Dans ce cas, il peut y avoir une vraie résistance au changement, qui se traduit par des lenteurs dans les demandes de raccordements, des frais importants qui sont imposés, ou dans le pire des cas, des procès et des assauts sur le terrain règlementaire.
Malgré tout, l’arrivée de nouveaux acteurs avec de nouvelles offres est perçue comme un levier pour pousser l’innovation dans des groupes qui ont perdu en agilité face à des investisseurs frileux qui préfèrent le statu quo. Par exemple, pour faire face à l’offre d’ENGIE, EDF a développé un tarif 100 % renouvelable pour ses clients, et ainsi de suite.
Un des enjeux importants des vingt prochaines années sera de trouver un modèle pour financer l’infrastructure énergétique et permettre à tous ces nouveaux acteurs de proposer un service fiable à leurs clients, qui couvre les frais d’entretien du réseau de transmission et de distribution. En effet, l’énergie circule dans un réseau de câbles et de fils qui suppose un investissement préalable de centaines de milliards d’euros auxquels viennent s’ajouter les couts de maintenance. Dans cet environnement, il est hors de question de construire des redondances réseau.
Enfin, un autre enjeu important, qui jouera également dans la sphère des politiques énergétiques, sera de trouver des mécanismes pour continuer à servir tous les clients et pas seulement les plus attractifs. Servir un client au bout du réseau ou en zone rurale peut couter très cher, et ce cout est actuellement partagé par tous les usagers. Impossible donc, avec les règles actuelles, de segmenter la clientèle et de ne servir que les clients les plus rentables, comme l’envisagent certains acteurs du marché.
Bill Gates avait lancé, en marge de la COP21 en 2015, la Breakthrough Energy Coalition, un fonds de plusieurs milliards de dollars destiné à financer la recherche de nouveaux outils pour fournir au monde une énergie non carbonée. Cette initiative a‑t-elle débouché sur des réalisations concrètes ?
Au même titre que les géants de la Tech poussent les structures en place pour accélérer la transition énergétique, des groupes d’investisseurs visent à remplacer ou à compléter l’action des gouvernements dans la recherche et le développement.
Parmi ces groupes, la Breakthrough Energy Coalition regroupe une trentaine d’investisseurs dont l’objectif est d’investir sur le long terme (20 ans) dans les technologies énergétiques. Les cycles longs d’investissement sont difficiles à couvrir pour les groupes de capitaux-risques traditionnels et c’est un rôle qui était jusqu’à présent réservé aux fonds gouvernementaux ou aux universités. Ce nouveau groupe inclut les plus grandes fortunes de la Tech comme Bill Gates (co-chair, Bill & Melinda Gates Foundation), Mark Zuckerberg et Dr. Priscilla Chan (CEO, Facebook, et CEO, The Primary School), parmi d’autres.
Depuis le lancement de l’initiative en 2015, je pense qu’aucune société n’a reçu de fonds, mais il est intéressant de noter que le groupe d’investissement a récemment annoncé Eric Toone et David Danielson comme leaders scientifiques du groupe. Les deux sont passés dans les rangs de l’US Department of Energy. Toone était à l’origine de l’US Department of Energy’s Advanced Research Projects Agency — Energy (ARPA‑E), qui a financé plus de 600 millions de dollars de projets depuis sa création en 2007.
Ici, les similitudes entre l’initiative de l’État fédéral américain et celui d’un groupe de leaders du secteur privé sont très fortes. De plus, quelques mois seulement après la nomination des deux hommes, le président Donald Trump a proposé un budget 2018 qui prévoit l’élimination de l’ARPA‑E, estimant que les impacts du programme sont difficiles à mesurer et que le programme est redondant avec d’autres programmes du gouvernement fédéral.
Je pense que les États et les régions ont un rôle clé à jouer dans l’accélération de la transition énergétique. Ils ont un intérêt certain à attirer ou garder les grands groupes dans leurs zones d’influence. Il va y avoir de plus en plus d’annonces d’États et de régions qui souhaitent aller plus vite que les gouvernements nationaux. La région Provence-Alpes-Côte d’Azur, où je vis actuellement après avoir passé huit ans en Californie, dispose d’énormes atouts en la matière.
Il existe plusieurs exemples de cette tendance aux États-Unis où la Californie, Hawaii, et d’autres ont déjà pris les devants de la lutte contre le réchauffement climatique face au laxisme de l’État fédéral américain. L’administration Trump, qui s’est retirée des Accords de Paris et qui est ouvertement en faveur des centrales à charbon et à gaz, a récemment enterré le « Clean Power Plan » – un plan qui prévoyait la fermeture des centrales les plus polluantes du pays. Ce plan était pourtant soutenu par la majorité des États ainsi que par les corporations comme Google, Apple, Amazon, Microsoft, et bien d’autres. Cette annonce au niveau fédéral est reçue par les États comme le signal de départ d’une course contre la montre qui les pousse à accélérer le processus. En 2015, l’État d’Hawaii a annoncé un objectif de 100 % d’énergies renouvelables pour 2045. La Californie a introduit le Senate Bill 100 en janvier 2017, qui vise également 100 % d’énergies renouvelables pour l’État avant le 31 décembre 2045. La loi n’est pas encore adoptée, mais elle a de grandes chances de l’être courant 2018.
Comment ce modèle de transition énergétique 2.0 prend-il en compte la particularité de l’énergie, comme bien nécessairement collectif qui inclut les zones connectées comme les plus reculées et les plus pauvres de la planète ?
Jusqu’à présent, aux États-Unis, la majorité des politiques qui ont favorisé le développement des ressources énergétiques distribuées (comme l’Investment Tax Credit, le Self Generation Incentive Program, etc.) ont bénéficié directement aux classes moyennes et aisées qui ont les moyens d’investir dans des véhicules électriques ou des systèmes photovoltaïques. En effet, pour obtenir un contrat de leasing sur des panneaux solaires par exemple, il faut justifier d’une solvabilité importante, ce qui s’avère difficile pour les employés précaires. De plus, les propriétaires ont un accès privilégié à ce type d’investissement et reçoivent des réductions d’impôts pour ce faire. Certaines sociétés essaient de trouver des solutions innovantes pour les foyers à revenus moyens, les locataires, et d’autres groupes de clients qui ne bénéficient pas du même accès, mais le progrès est lent.
Cela commence à poser un vrai problème d’équité pour les régulateurs américains et les ONG qui protègent les consommateurs. D’autant plus que la structure des contrats comme le Net Energy Metering – qui permet à un producteur résidentiel d’énergie solaire de vendre son énergie au réseau au prix résidentiel fort – opère un transfert implicite des couts d’entretien du réseau sur les clients qui n’ont pas accès au solaire. Il existe de plus en plus de procédures politiques qui visent à trouver des solutions plus inclusives pour que les bénéfices du solaire soient partagés par tous. Chaque client du réseau a un cout de service pour le fournisseur qui est différent. Le régulateur impose de servir tous les clients et d’en démocratiser le prix.
En France, le décret relatif à l’autoconsommation collective, adopté en avril 2017, pourrait favoriser la mise en œuvre de nombreuses stratégies d’inclusion en ouvrant la voie à une multitude de nouvelles configurations dans le secteur du solaire résidentiel. Plusieurs startups françaises, comme Sunchain, sont en train de se positionner sur ce créneau.
Entretien réalisé par Nathalie Vergeron