La décennie 2010 révèle un paysage énergétique chaotique, dans une Europe tenaillée entre ses efforts de réduction des émissions de carbone et la découverte impromptue de ressources d’hydrocarbures non conventionnels dans son sous-sol, le tout sur fond de crise économique durable, de menaces sur sa compétitivité industrielle et de pression drastique sur les budgets publics de ses États.
Pour avancer dans cette complexité, il faut tout d’abord prendre la mesure des efforts de transition énergétique dans lesquels l’Union européenne est engagée : la vision commune est de diminuer les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 80 % à l’horizon 2050 (et, d’ores et déjà, de 20 % en 2020 par rapport au niveau de 1990). Et c’est dans ce cadre que, sans l’avoir anticipé, l’Europe se réveille très soudainement dotée en ressources carbonées, c’est-à-dire en gaz de « schiste » (ainsi qu’en pétrole de schiste, en gaz de houille…). Cette découverte est fondamentalement liée aux mouvements de fond sur le marché pétrolier. Avec un prix du pétrole qui, en moyenne, a été multiplié par quatre en dix ans (de 25 à 100 dollars le baril environ), l’espace économique s’est considérablement élargi autour de nouvelles familles d’hydrocarbures profondément enfouis sous la terre ou sous la mer (pétrole et gaz dits « en off-shore profond »), y compris jusque dans l’Arctique. Ces ressources ont également une grande valeur, car elles permettent de diversifier les lieux d’extraction, rebattant ainsi les cartes économiques entre pays producteurs et importateurs, et réduisant les risques géopolitiques.
Dans ce contexte, en moins d’une décennie, les réserves potentielles de gaz naturel sont passées de soixante années de consommation à deux cents ans, voire davantage si l’on considère toutes ses formes d’enfouissement géologique. Il est certes délicat, à ce stade très préliminaire du débat en Europe, d’évoquer des quantités exploitables et de faire des paris économiques. L’estimation la plus optimiste fait cependant état de 17 000 milliards de mètres cubes de gaz, soit 10 % environ du potentiel mondial (lui-même très incertain) (1) contre plus de 25 % pour les États-Unis. Par comparaison, la consommation européenne annuelle est d’environ 500 milliards de mètres cubes, les importations représentant 40 % de ce total. Ces volumes enfouis dans le sous-sol européen sont insuffisants pour entrevoir une révolution de même portée que le bouleversement en cours aux États-Unis (d’autant que les coûts d’exploitation devraient être plus élevés), mais ils pourraient compenser en partie l’épuisement des ressources conventionnelles encore disponibles dans l’Union (aux Pays-Bas notamment), et réduire la facture d’importation des États-membres.
Le gaz de schiste : une manne ou une malédiction ?
Le gaz de schiste est-il compatible avec la transition énergétique dans laquelle s’engagent les Européens ? Pourrait-il contrebalancer nos importations croissantes en provenance du Sud de la Méditerranée, du Moyen-Orient et surtout de Russie ?
Tous les Européens n’apportent pas, pour l’heure, la même réponse à ces différentes questions. Tandis le Danemark, la Pologne, le Royaume-Uni, l’Allemagne ou encore l’Espagne ont ouvert la voie à l’exploration ou l’exploitation, la France, la Bulgarie, la Tchéquie, le Luxembourg et les Pays-Bas s’y sont opposés, pour l’instant tout au moins. Voir l’Europe ainsi partagée n’est pas réellement surprenant, notamment parce que ce type de décision est de la prérogative des États, et que les contraintes locales sont très hétérogènes : état des mix énergétiques et dépendance aux importations d’hydrocarbures, nécessité ou non de sécuriser rapidement les approvisionnements, état des écosystèmes et attractivité touristique des zones d’exploration, la sensibilité au sujet varie d’un pays à l’autre, d’une région à l’autre, même. Dans des environnements où la densité de population est généralement plus élevée qu’aux États-Unis, les craintes suscitées par la fracturation hydraulique (seule technologie disponible pour l’heure) sont pour les Européens assez logiques, ainsi que les préoccupations liées à l’impact en surface du cycle d’exploitation (organisation d’une chaîne logistique de transport des matériels et du gaz, stockage en surface…). Et ces levées de boucliers contre le gaz de schiste ne sont d’ailleurs qu’une des facettes du syndrome « pas dans mon jardin », frappant de nombreux projets énergétiques européens, même verts, comme pour les éoliennes… Quoi qu’il en soit, le débat public doit avoir lieu, ainsi que la recherche d’autres types de technologies que la fracturation hydraulique.
En laissant de côté ces questionnements légitimes sur l’acceptabilité des technologies, tentons d’ébaucher ici le panorama économique et géopolitique dans lequel s’inscrit cette perspective d’une exploitation par les Européens de leurs ressources locales en hydrocarbures.
Pour comprendre ce qui se joue, il faut tout d’abord regarder vers l’Ouest, en prenant la mesure des impacts sur l’Europe de la révolution du schiste américain. Comme on le sait, aux États-Unis, l’exploitation n’a pas donné lieu à un débat public aussi intense qu’en France (notamment parce que les propriétaires du sol sont également propriétaires du sous-sol). L’exploitation rapide (et parfois mal encadrée) a induit un prix du gaz quatre fois inférieur aux niveaux européens (et six fois même, relativement aux niveaux asiatiques) avec des retombées sur la compétitivité des industries intensives en énergie. Dans une étude de 2012, la société américaine IHS estime que l’usage local du gaz et du pétrole non conventionnel aux États-Unis pourrait induire la création directe ou indirecte de 3 millions d’emplois en 2020 et 110 milliards de dollars de recettes publiques par an à ce même horizon (2). Par temps de crise, l’impact sur la compétitivité industrielle, de ce côté de l’Atlantique, doit naturellement être scruté. L’effet sur la pétrochimie est, à ce stade, le plus notable : au lieu de produire de l’éthylène à partir de naphta (dérivé pétrolier), les industriels américains privilégient l’éthane, en profitant de la faiblesse du prix du gaz, leurs concurrents européens pâtissant d’un désavantage de 30 à 50 % sur le produit final. Ce type d’avantage pourrait être réduit si les Américains exportaient leur gaz, ce qui aurait pour effet d’augmenter son prix intérieur et de réduire ce désavantage des compagnies européennes intensives en énergie. Mais la pression est forte pour garder ce gaz dans les frontières nord-américaines et continuer à en tirer les bénéfices par rapport aux concurrents asiatiques et européens. Une compagnie britannique, Centrica, a cependant annoncé en mars 2013 avoir passé avec l’américain Cheniere un contrat d’achat de GNL (gaz naturel liquéfié) sur vingt ans à compter de 2018, ce qui pourrait amorcer des flux transatlantiques de gaz.
Le gaz américain a un autre impact très direct, et plus inattendu, en Europe : dans la région du monde pourtant la plus avancée en matière de transition énergétique « bas carbone » qu’est l’UE, le charbon aura été « l’énergie-star » en 2012, ainsi que très probablement en 2013. Ce singulier paradoxe s’explique par le fait que les États-Unis se trouvent excédentaires en charbon, car les producteurs électriques lui préfèrent le gaz, devenu très bon marché. Ce charbon excédentaire est notamment exporté vers l’Europe où, le prix du CO2 étant également au plus bas en raison de la crise, cette ressource devient plus avantageuse pour la production d’électricité, alors même qu’elle émet environ deux fois plus de CO2 que le gaz naturel. Le cas le plus emblématique est celui de l’Allemagne qui, tout en prenant le leadership mondial de la transition avec son « Energiewende » (tournant énergétique), assure près de 50 % de sa production électrique en recourant au charbon : entre 2011 et 2012, les centrales allemandes à base de houille ont vu leur part monter de 18,5 % à 19,1 %, celles à base de lignite de 24,6 % à 25,6 % dans le bouquet électrique. Cette bascule transatlantique n’est probablement que transitoire, car les directives européennes et la modification dans la règle d’allocation des quotas de CO2 tendront à évincer les centrales à charbon les plus polluantes d’ici à fin 2015. Mais cette « arabesque » illustre les effets en chaîne provoqués par la révolution des gaz de schiste.
L’Europe face au bouleversement de la géopolitique des hydrocarbures
Cette apparition des hydrocarbures non conventionnels porte également en germe un bouleversement de la géopolitique des hydrocarbures qui doit tenir les Européens en alerte. Vers 2030, les États-Unis pourraient avoir acquis une quasi-autonomie en pétrole et en gaz, à l’opposé de la trajectoire suivie par l’Europe. Il y a là également un sujet de réflexion manifeste, voire de grande préoccupation, pour des Européens qui doivent repenser leur sécurité d’approvisionnement dans ce nouveau paysage énergétique (3). Quelle serait l’attitude d’un partenaire américain moins préoccupé par ses importations d’hydrocarbures, notamment en provenance du Moyen-Orient ? Comment les Européens gèreront-ils la concurrence accrue pour l’accès aux ressources avec cette autre région du monde fort importatrice qu’est l’Asie ?
Ces menaces doivent, avant toute chose, conduire les Européens à faire des efforts considérables d’efficacité énergétique, pour contenir leurs importations : l’Agence internationale de l’Énergie estime que, si de tels efforts sont réalisés, l’Europe réduira ses dépenses énergétiques de 400 milliards d’euros en 2035, comparativement au niveau actuel. Un tel effort est indispensable (chaque molécule d’énergie fossile non importée nous met un peu plus à l’abri des fracas du monde), mais ne suffira pas à nous immuniser, car du gaz, en grande quantité, sera nécessaire notamment pour équilibrer des systèmes électriques où les énergies renouvelables occuperont une place plus grande au fil des décennies (les centrales à gaz prenant leur relais lorsque le vent ou le soleil manqueront).
Les Européens sont donc tenus, à court ou moyen terme, de réintroduire leurs ressources non conventionnelles dans l’espace du débat sur la politique énergétique. À cette fin, trois questions permettent de circonscrire la réflexion.
Primo, l’exploitation des gaz de schiste ne constituerait-elle pas une contradiction flagrante avec l’ambition de l’UE d’une transition énergétique réduisant les émissions de CO2 ? Non, produire du gaz en Europe nous permettrait d’en importer moins, mais pas d’en consommer davantage, car nous sommes tenus par nos engagements collectifs de réduction des émissions de CO2.
Toute molécule de gaz extraite dans les frontières de l’Union est soumise à cet engagement communautaire de transition énergétique. À l’inverse, certains de nos fournisseurs, comme l’Algérie ou la Russie, utilisent leurs recettes d’exportation pour pouvoir vendre chez eux le gaz à bas prix et émettre ainsi davantage de CO2… Produire du gaz en Europe, en réduisant les ressources financières de certains de nos fournisseurs, contraindrait cette politique de subventionnement local et pourrait les conduire à réfléchir ainsi à leur propre transition énergétique. Nous sommes, à nouveau, en présence d’un paradoxe : produire du gaz en Europe, c’est-à-dire dans un espace qui réglemente ses émissions, plutôt que de l’importer, pourrait concourir à une réduction des émissions globales…
Deuxio, l’exploitation du gaz de schiste pourrait-elle servir la transition énergétique en Europe ? Dans le contexte des fortes contraintes sur les finances publiques que l’on sait dans beaucoup d’États-membres, les bénéfices d’une production du gaz en Europe pourraient accompagner la transition énergétique : énergies renouvelables, rénovation thermique des bâtiments, stockage de l’énergie, capture et séquestration de carbone, précarité énergétique (qui frappe des dizaines de millions de ménages européens), les chantiers à financer sont très nombreux. La Commission considère que l’UE sera tenue d’engager chaque année 270 milliards d’euros jusqu’en 2050 pour réussir sa transition énergétique (4). Des politiques « iconoclastes » sont à inventer, en subordonnant l’exploitation des énergies fossiles au service du développement de celles appelées à les remplacer. Des exemples de ces associations « contre nature » existent : la Norvège est riche d’hydrocarbures, mais produit pourtant presque 100 % de son électricité via son parc hydraulique (soit au niveau le plus élevé d’Europe), tandis que le Texas, malgré ses derricks et puits de fracturation, est le premier État éolien outre-Atlantique, très loin devant la verte Californie. Plus proche de nous, le Danemark, pourtant recouvert d’éoliennes et visant une production électrique 100 % renouvelable en 2050, a autorisé l’exploration de son potentiel en gaz de schiste par fracturation. Le message essentiel est que la bataille de la transition énergétique ne doit pas être conduite sur les lignes du front du XXe siècle…
Tertio, si exploiter restait difficilement envisageable, y aurait-il néanmoins un intérêt à explorer ? L’exploration – c’est-à-dire la réalisation de tests pour évaluer le potentiel géologique et économique réel des ressources non conventionnelles – a une valeur intrinsèque, même sans engagement direct dans l’exploitation. Dans un monde où les pays émergents, Chine et Inde en tête, ont lancé une course aux énergies fossiles (de même que le Japon depuis Fukushima) et où, à l’inverse, les États-Unis s’orientent vers une autarcie énergétique, les Européens dans leur ensemble ont un intérêt à faire l’inventaire des ressources disponibles dans leur sous-sol, au nom du « principe de précaution » pour l’avenir. Leurs marges de manœuvre dans le monde complexe qui s’annonce seront également fonction de ces ressources qui constituent des « réserves stratégiques » et qu’il convient donc d’évaluer avec précision. Les Polonais, par exemple, ont découvert que leurs ressources étaient deux fois moins prometteuses que prévu, en regardant de plus près… Autre intérêt de l’exploration en tant que telle : cette évaluation peut constituer un argument de négociation avec nos fournisseurs. Le gaz qui entre en Europe est largement lié à des contrats de long terme indexés sur le prix du pétrole. Autrement dit, nous payons le prix d’un gaz très abondant au niveau mondial (mais difficile à transporter, il est vrai) au prix du pétrole qui est tiré vers le haut par la Chine et l’Inde. C’est ce qui conduit au grand retour du charbon en Europe, plus avantageux que du gaz que nous devons payer comme de l’or noir… Le gaz de schiste européen peut être l’un des éléments de cette négociation avec nos fournisseurs pour obtenir de meilleurs prix ou des contrats plus souples. Les ressources non conventionnelles sont désormais une arme de la diplomatie du gaz en Europe.
Notes
(1) Cf. European Commission, « Unconventional gas : potential energy markets impacts in the European Union », JRC Scientific and Policy Reports, 2012.
(2) IHS, « America’s New Energy Future : The Unconventional Oil and Gas Revolution and the US Economy », 2012.
(3) J.-M. Chevalier, P. Geoffron (éd.), The New Energy Crisis, Palgrave McMillan, 2013.
(4) Commission européenne-DG Climat, Feuille de route vers une économie compétitive à faible intensité de carbone à l’horizon 2050, mars 2011.




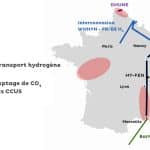


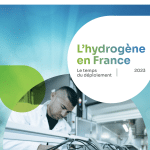


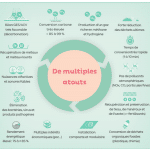






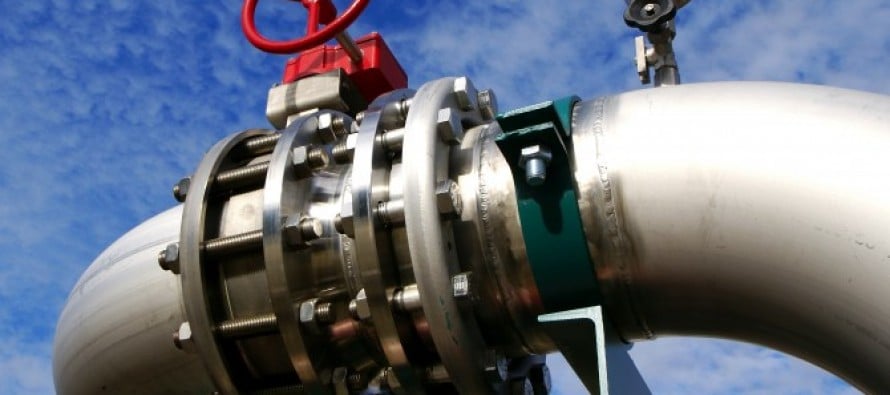


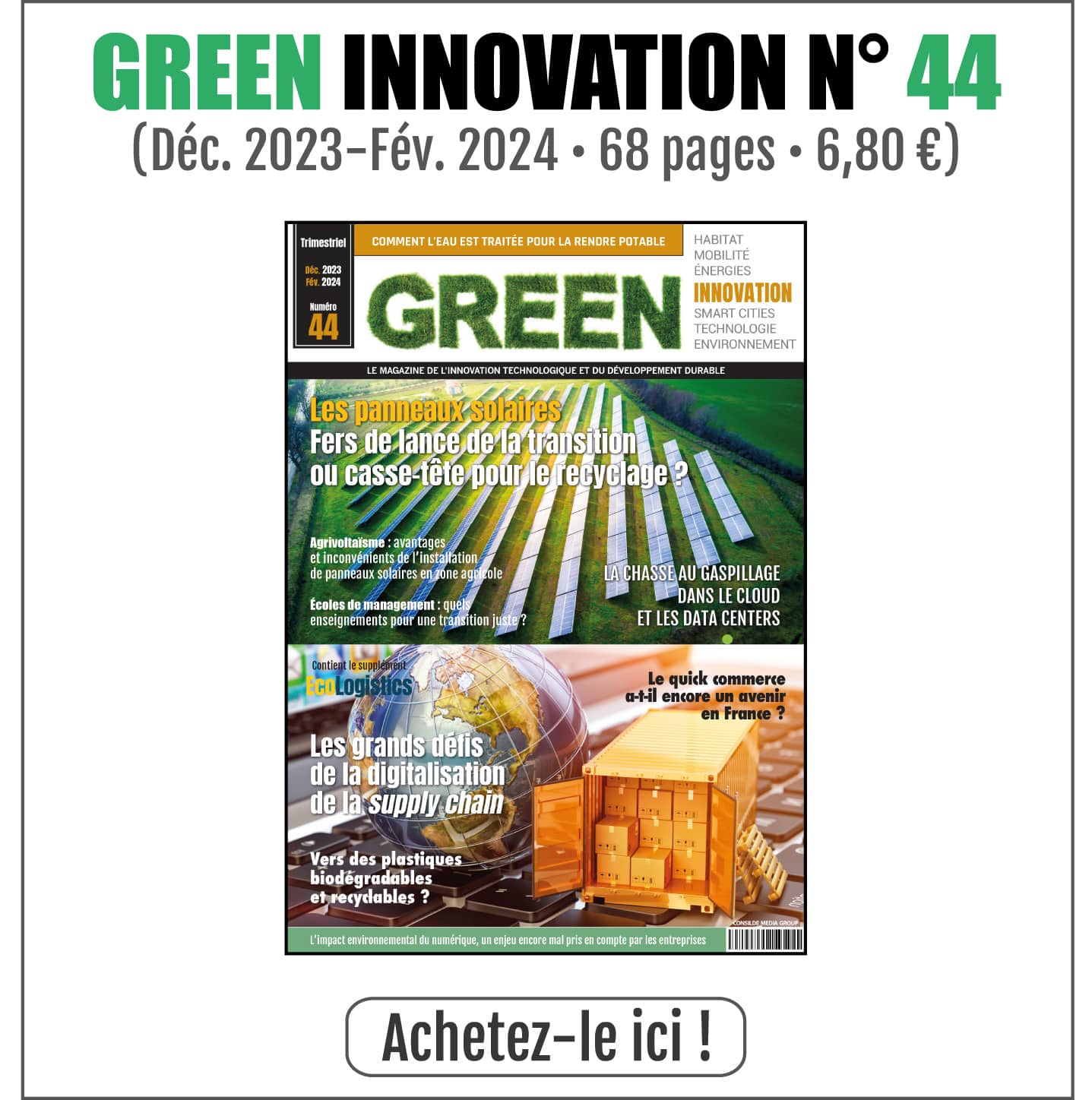

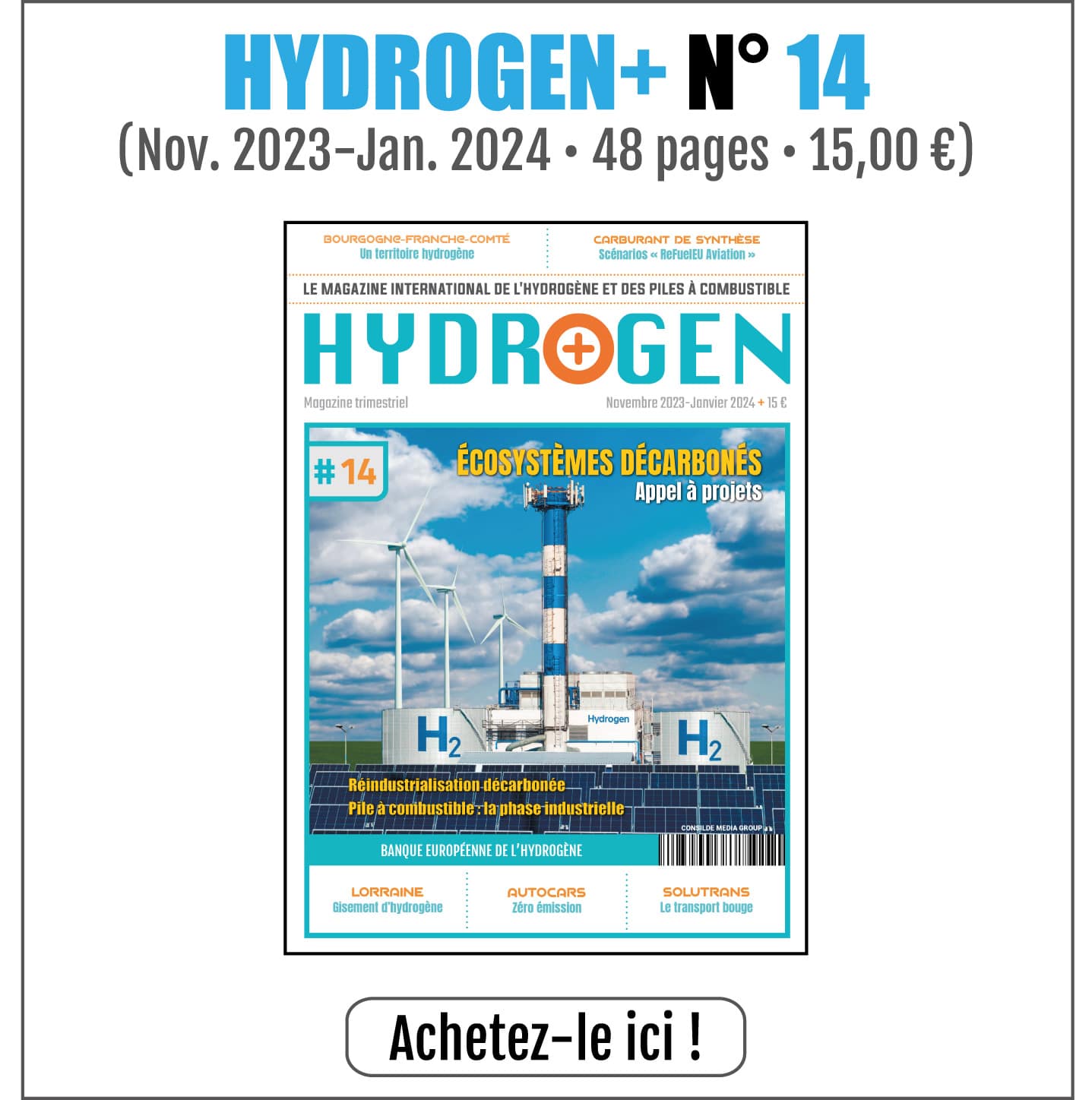


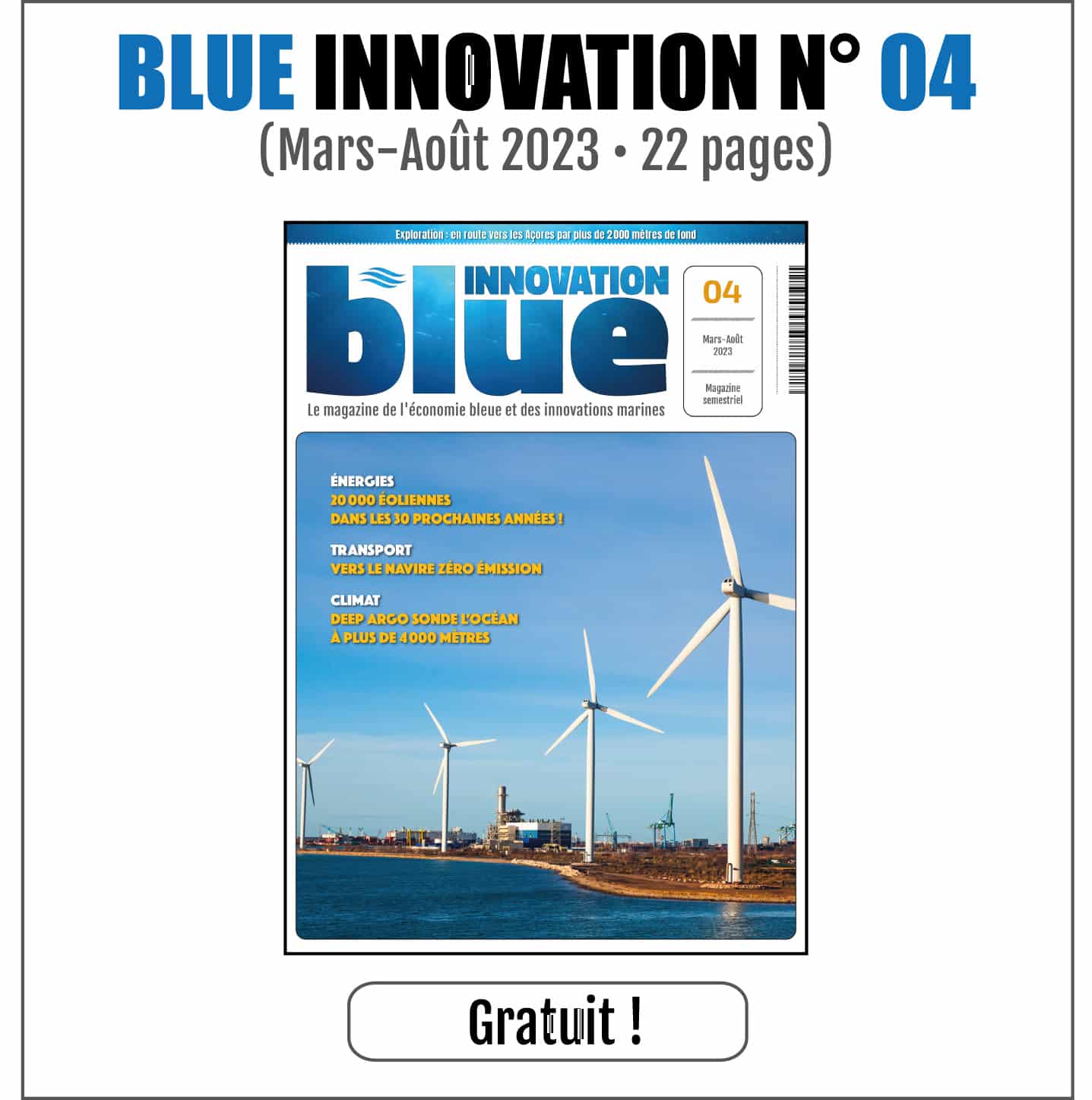
Ajouter un commentaire